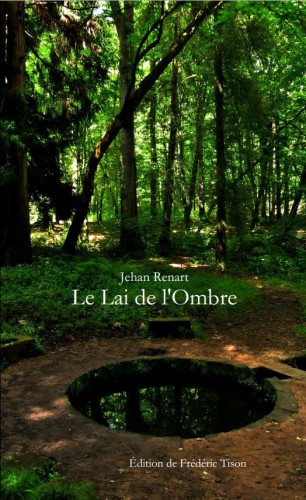mardi, 12 avril 2016
Entretien avec Jean de Rancé — Sur le poème, et le poème en prose en particulier
Jean de Rancé.-. Cher Frédéric Tison, vous venez de publier un nouveau livre de poésie, Le Dieu des portes, aux éditions Librairie-Galerie Racine. En le feuilletant tout d'abord j'ai été surpris : c'est là un livre entier de poèmes en prose, ce qui est une première pour vous, si je ne me trompe.
Frédéric Tison.-. Vous avez tout à fait raison, cher Jean de Rancé. J'ai bien écrit, naguère, ou plutôt jadis, des livres entiers de prose (Histoires amnésiques, puis Les Contemporains intérieurs), mais il ne s'agissait pas véritablement de poèmes en prose, plutôt de courts récits ou de contes.
J. de R.-. Précisément, pourquoi le poème en prose ?
F. T. -. Le vers, que je creuse par ailleurs et qui m'est très cher, laisse parfois de côté certains états de la pensée et de l'émotion. Le poème en prose est propice à quelque traduction nouvelle, m'est-il apparu. Son exigence n'est pas moins grande que celle du poème en vers, et son rythme particulier me tentait depuis longtemps.
D'autre part, j'essaie de construire des livres qui ne soient pas de simples recueils de poèmes épars, mais qui possèdent une cohérence interne forte, où chaque poème trouve sa place unique, et dont la fluidité suppose une lecture continue, et "logique", de la première à la dernière page. Adopter d'abord une même forme pour l'ensemble des textes m'a semblé, dans le cas précis de ce livre, l'une des conditions de cette cohérence, même si, naturellement, il me serait tout à fait envisageable de composer un livre de poèmes en prose et en vers mêlés, de même qu'il n'entre pas ici de considérations exclusivement formelles. Disons tout simplement, à la fin, que tout le livre s'est écrit dans l'intention d'en faire un livre de poèmes en prose.
J. de R.-. Le sous-titre du Dieu des portes est "Histoires en peu de phrases" : est-ce à dire qu'il s'agit là de contes rapidement narrés ?
F. T.-. Vous pouvez très bien entendre le mot histoire dans le sens de conte, en effet, et plusieurs textes ont pour trame une "histoire", un "récit", ou plutôt un fragment d'histoire ou de récit, même s'ils n'en sont pas à proprement parler. Mais histoire possède également le sens d'image (songeons aux manuscrits historiés des monastères médiévaux ou à ceux de la Librairie de Jean de Berry, par exemple). Quant au reste du sous-titre, il s'agissait, notamment, de souligner la brièveté des textes : il me semble en effet qu'un poème en prose, de même qu'un poème en vers, a plus de force quand il tient sur une page, quand le regard peut l'appréhender tout ensemble immédiatement. Dès lors, me direz-vous, les épopées en vers de jadis et de naguère, de la Chanson de Roland à Victor Hugo en passant par Agrippa d'Aubigné, ne pourraient plus faire aujourd'hui figure de poèmes ! Il serait stupide de le dire, bien sûr, mais il me semble (je précise que ceci ne vaut que pour moi) que notre époque appelle le poème court, lequel est de nature à dire ce qui nous arrive : le morcellement, la déréliction, la fluidité, l'extase, le moment saisi dans sa verticalité, mais aussi le tâtonnement, au sein de (et contre) la vitesse et la surcharge. Certains poèmes en prose selon Baudelaire, dans Le Spleen de Paris, me semblent tendre parfois vers la nouvelle, voire vers l'étude ; je pense au "Mauvais Vitrier", ou à "La Solitude", tandis qu'un texte comme "Le Port" atteint d'emblée la dimension du poème, sans que l'on se préoccupe, pour le définir en tant que poème, qu'il soit de vers ou de prose. De même, "Frisson d'hiver" ou "Réminiscence", chez Mallarmé, me semblent tendre davantage vers le "véritable" poème en prose que, par exemple, "La Déclaration foraine", qui est pourtant présenté comme tel par le poète — où je ne dis pas, faut-il le préciser, que ce dernier texte n'est pas en tout point admirable. Chez les modernes, c'est du côté de Pierre Reverdy, Antonin Artaud, Robert Desnos ou Louis Guillaume que se trouvent, selon moi, les plus belles réussites de ce genre à part.
J. de R.-. Le poème en prose n'est pas, bien sûr, de la prose poétique...
F. T.-. ... Non pas !
J. de R.-. ... mais il n'est pas non plus comparable à une suite de versets, dont l'origine est biblique, voire védique, et que l'on retrouve à l'époque moderne, notamment, chez des poètes tels que Paul Claudel ou Saint-John Perse, et aujourd'hui chez Pierrick de Chermont.
F. T. -. Il est vrai qu'il n'est ni l'une ni l'autre, même si le rythme particulier du verset peut s'y manifester parfois, je pense par exemple à certaines anaphores. Mais le poème en prose, est-ce une hésitation entre le verset et la prose française classique ? Je ne le crois pas ; ce n'est pas un genre hybride ; il s'agit d'une possibilité infiniment fertile, d'une autre solution du rythme de la langue.
Et de même que le vers dit "libre" de la poésie moderne est l'objet de très nombreuses métamorphoses, d'ailleurs plus ou moins heureuses, le poème en prose peut être réinventé par celui qui en use.
Quant à la "prose poétique", j'y reviens, cela n'a bien sûr rien à voir : le poème en prose n'est en rien une prose ornée, ni une prose qui imiterait lointainement le vers : chacune de ses phrases doit pouvoir se tenir solidement de telle sorte qu'en modifier un mot en amoindrirait la structure tout entière. Je ne parle pas seulement d'une syntaxe forte, que je crois absolument nécessaire par ailleurs, mais aussi du fait que le poème en prose doit proposer un autre Chant. Un bon poème en vers est celui dont les vers ne tremblent plus, et il en est de même pour les phrases du poème en prose — et si le poème ralentit le regard, je veux dire toutes nos lectures, en élargissant, en espaçant.
J. d. R.-. Je reviens à cette idée d'histoire au sens de récit. Déjà, Les Ailes basses, un livre que vous avez publié en 2010, avait pour sous-titre "Poèmes pour un Narrateur". Quelle serait la relation entre le poème et la narration ?
F. T.-. Cette relation est essentielle et lointaine à la fois. Le poème ne raconte pas comme un récit, une nouvelle ou un roman le feraient, mais il se nourrit de récits et d'histoires, de légendes et de mythes tout aussi bien. L'une de ses trames profondes, ou l'une de ses lames de fond, est le temps, où se déploie l'histoire, où s'amorcent, se développent et s'achèvent des histoires, et non seulement celles de l'auteur. Il est dans mes projets de composer un jour un livre de ballades en prose ; et dans toute ballade n'entre-t-il pas les éléments d'une histoire vécue ou légendaire ?
J. de R. -. Vous avez évoqué Mallarmé. Avez-vous lu ce qu'on écrit de vous à propos du « souci mallarméen » de vos écrits ? Qu'en pensez-vous ?
F. T. -. Oui, je l'ai lu bien sûr, ce sont les mots louangeurs de Paul Farellier. M'inscrirais-je dans une lignée mallarméenne ? J'en serais bien aise, et honoré — cependant ce n'est pas à moi de dire si mes écrits sont dignes ou non de ces mots.
Vous connaissez sans doute ce qu'écrivit Paul Léautaud, au lendemain de la mort de Mallarmé, le 10 septembre 1898, dans son Journal littéraire :
« Les journaux, ce matin, annoncent la mort de Mallarmé, hier, subitement, dans sa petite maison de Valvins. Celui-là fut mon maître. Quand je connus ses vers, ce fut pour moi une révélation, un prodigieux éblouissement, un reflet pénétrant de la beauté, mais en même temps qu'il me montra le vers amené à sa plus forte expression et perfection, il me découragea de la poésie, car je compris que rien ne valait que ses vers et que marcher dans cette voie, c'est-à-dire : imiter, ce serait peu digne et peu méritoire. (…) Les vers de Mallarmé sont une merveille inépuisable de rêve et de transparence. (…) Mallarmé est mort. Il a enfoncé le cristal par le monstre insulté. Le cygne magnifique est enfin délivré. Et quelle qualité : il était unique. »
Je n'ai nullement été « découragé », pour ma part, de la poésie, devant un modèle ; même les plus beaux vers de Charles d'Orléans, de Scève, de Hugo, de Baudelaire, de Verlaine, de Mallarmé, de Jouve, de Reverdy ou d'Aragon n'ont su entamer ni briser mon désir d'écrire des mots qui tentent de former un poème. Jamais je n'ai voulu imiter, tout du moins jamais après mon adolescence. Je n'ai jamais pensé que « rien ne valait que » les vers de l'un ou de l'autre, même si j'étais ébloui par eux ; mais précisément, ils étaient si différents les uns des autres, ils exprimaient tant, et cela, avec des moyens si souvent étrangers les uns aux autres, qu'il ne m'a pas semblé que je ne pusse entreprendre d'ajouter, même modestement, ma voix aux leurs — fût-ce au prix d'une naïveté ou d'un orgueil, peut-être, mais qu'importe, à la fin, si cela est un désir.
Vous voyez que j'ai cité Mallarmé parmi d'autres poètes que j'aime : il ne faudrait pas croire que sa figure éclipse selon moi toutes les autres, bien au contraire.
J. de R.-. Pourriez-vous tout de même préciser ce que représente, en particulier, pour vous la poésie selon Mallarmé ?
F. T.-. J'ai déjà, à la fin d'un précédent entretien, évoqué avec vous sa troublante définition selon laquelle
« La Poésie est l’expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence : elle doue ainsi d’authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle ».
Cette fameuse « tâche spirituelle », qu’il est très délicat de définir exactement selon les termes généraux du poète, n’est-elle pas elle-même fort troublante ? Qu’entendait le poète par là ? Et ce « sens mystérieux », renvoie-t-il à l’énigmatique trouble "commun", dirai-je, celui auquel le monde nous soumet, par notre seule présence, d’abord insensée, au monde, ou bien également, ou premièrement, au Mystère médiéval chrétien, auquel fait référence le poème d’Hérodiade, Mystère en tant que scène théâtrale, où se joue, se rejoue plutôt, quelque épisode décisif, ultime et sacré, quelque Drame, écho lui-même des antiques tragédies grecques données au cœur de la cité ? Ces mots de Mallarmé sont si gorgés, voire si saturés de sens qu’il nous appartient, selon moi, de les examiner avec autant de soin que nous examinons le sonnet en yx. C'est cette exigence que j'aime chez Mallarmé, et l'élégance étonnante qui en résulte. Il nous resterait encore à examiner l'autre proposition de Mallarmé selon laquelle tout, au monde, existe pour aboutir à un Livre. Il est indéniable que cette pensée m'a profondément troublé, et que je n'ai jamais achevé l'un de mes ouvrages sans y songer. Mais ceci nous mènerait trop loin aujourd'hui, dans cet entretien qui est déjà peut-être trop long...
J. de R.-. Eh bien, nous aurons l'occasion d'y revenir. Avant de clore cet entretien, j'aimerais revenir au Dieu des portes. Il me semble que de nouveaux thèmes y sont abordés, et certains passages pourront peut-être apparaître un peu surprenants sous votre plume...
F. T.-. Une poésie accomplie (ou plutôt, en train de s'accomplir) est celle qui peut tout accueillir en son sein sans se trahir ; le poème sait coucher dans le lit de sa voix le murmure de la rivière comme le haut chant du torrent, l'ordure comme la grâce. Mais elle ne saurait le faire qu'en y soufflant, comme on souffle sur une braise pour faire un grand feu rougeoyant.
(Propos recueillis le lundi 11 avril 2016.)
17:36 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens, Sur le poème | Tags : frédéric tison, jean de rancé, entretien | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
jeudi, 26 mars 2015
Entretien avec Jean de Rancé — à propos du « Carnet d'oiseaux »
Jean de Rancé. -. Cher Frédéric Tison, après le cahier de poèmes illustré d'encres et de gravures Une autre ville (2013), après la carte "poème-estampe" « Les Herbes le soir » (2014), voici que le troisième fruit d'une collaboration avec l'artiste Renaud Allirand vient de mûrir : Carnet d'oiseaux. Comment est né le projet qui mena jusqu'à cet ouvrage ?
Frédéric Tison. -. Cher Jean de Rancé, j'avais dans mes chemises et mes tiroirs quelques textes écrits autour de la figure de l'oiseau, entendue bien sûr selon l'animal, qui me trouble, mais aussi selon son esprit, que chacun rêve, et que je suis le premier à rêver, d'une façon même naïve : je veux parler de l'être ailé, de l'ange peut-être, ce précipité, au sens alchimique, qui est en nous, cette "folie", cette vitesse légère et ce regard, cette hauteur peut-être, ce ciel certainement. J'avais depuis longtemps envisagé un petit livre qui serait consacré à cette figure et à son nom. Et, à ce propos, je pense souvent à Elmer (ou Oliver) de Malmesbury, qui est l'Icare médiéval ; j'ai découvert son existence dans la nébuleuse de mes lectures autour de la figure d'Edwine, personnage qui apparaît dans Les Ailes basses. C'est ce moine bénédictin anglais qui, au début du XIe siècle, tenta de voler grâce à des ailes mécaniques de sa conception : l'historien Guillaume de Malmesbury et le poète Hélinand de Froidmont (l'auteur des Vers de la Mort) ont raconté dans leurs Chroniques respectives comment Elmer, vers 1010, réussit, muni de ces ailes, à se jeter du haut d'une tour de l'abbaye de Malmesbury, dans le Wiltshire, et à maintenir son vol pendant deux cents mètres, avant de s'écraser au sol et de se briser les jambes, tantôt, selon les chroniqueurs, sous l'effet de la panique, Elmer ne parvenant plus à diriger ses ailes, tantôt à cause d'une bourrasque malvenue. Guillaume rapporte que cette mésaventure ne découragea nullement notre merveilleux et aimable moine : ce dernier voulut entreprendre un deuxième vol, en ajoutant cette fois une queue à son dispositif, laquelle aurait permis de le stabiliser, mais cela lui fut interdit par son abbé. Le Carnet d'oiseaux aurait pu lui être dédié, j'y pense maintenant ; j'aurais dû le mentionner...
Mais où en étais-je ? Ah oui... Lorsque je découvris certaines des encres de Renaud Allirand dont le sujet était, justement, l'oiseau, je fus très séduit : ces magnifiques petites encres sur papier, pleines de vitalité, m'inspirèrent quelques "poèmes" ; je suggérai à l'artiste un livre commun, où quelques-unes de ses encres illustreraient d'anciens et nouveaux textes miens. Il accepta. Dès lors nous conçûmes ce livre que vous avez dans vos mains. Je choisis un peu moins d'une trentaine d'encres (vingt-sept exactement), et deux gouaches (lesquelles illustrent la couverture de cet ouvrage). Nous cherchâmes infructueusement un éditeur de livres d'artiste, puis nous tournâmes vers les possibilités nouvelles qu'offre l'Internet, notamment, dans ce cas précis, vers un éditeur en ligne, nommé Bibliocratie, qui propose des souscriptions : l'éditeur se charge d'élaborer un livre à condition qu'un certain nombre d'exemplaires souscrits soit atteint, ce qui évite l'inutile ou ruineux "compte d'auteur", etc. ; ceci n'est pas très intéressant, c'est pourquoi je vous passerai les détails ; mais, j'y viens, cela porta ses fruits : l'ouvrage obtint 76 souscriptions (j'en ôte les vingt exemplaires que nous commandâmes, l'artiste et moi), chiffre considérable dans un contexte aussi confidentiel.
J. de R. -. Racontez-nous, si vous le voulez bien, la genèse des cinq parties de cet ouvrage.
F. T. -. Pour l'anecdote, le titre initial était au pluriel : Carnets d'oiseaux, car l'ouvrage est composé de cinq parties en vers et en prose, très différentes les unes des autres. Mais le singulier l'emporta, pour des raisons de clarté : lire les « Carnets d'oiseaux » (lesquels ?), etc., cela n'allait pas.
Le plus ancien des textes est contenu dans la partie III., « Les Petits Oiseaux de Theuth » ; il date de 2007, et a été entièrement refondu et récrit en 2012. « Le Dit de la voix » (partie II.) date de 2013. Les parties I. et V. datent de l'été 2014. Quant aux « Fragments d'un volucraire », qui se présentent sous la forme d'entrées de journal, ils furent composés de mars 2012 à mars 2014. J'ai pensé rassembler ces textes très divers, qui dormaient pour ainsi dire, lorsque je découvris les encres de Renaud Allirand : soudain j'en vis la trame commune, et le livre devint, en quelque sorte, nécessaire. Sans doute appelaient-ils l'image...
J. de R. -. En quoi les « Oiseaux » de Renaud Allirand vous ont-ils particulièrement séduit ?
F. T. -. J'aime que ces encres soient à la fois, comme souvent d'ailleurs chez l'artiste, à mi-chemin entre l'abstraction et la figuration : nous y reconnaissons aisément la figure de l'oiseau, mais l'oiseau est dans le même temps, ou le même regard, un pur trait calligraphique, il est pour ainsi dire enfanté par le geste de la main et le pinceau. À son tour le trait se voit pourvu d'ailes...
J. de R. -. Un autre livre d'artiste verra-t-il le jour, s'il n'est pas déjà en préparation ?
F. T. -. Seul Hermès, dieu des messagers et des messages, le sait déjà.
18:58 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens | Tags : frédéric tison, entretien, entretien avec jean de rancé, jean de rancé, carnet d'oiseaux, renaud allirand | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 14 janvier 2015
Entretien avec Jean de Rancé — À propos de « Si la demeure »
Jean de Rancé. -. Cher Frédéric Tison, vous avez publié récemment un ouvrage consacré au Belvédère, la maison de Maurice Ravel à Montfort-l'Amaury. Pourriez-vous nous retracer l'histoire de ce livre ?
Frédéric Tison. -. Cher Jean de Rancé, bien volontiers. Je ne me suis pas rendu au Belvédère dans l'intention de faire un livre de cette visite. Tout au plus comptais-je en prendre quelques photographies destinées à mes carnets puis à ce blogue. Mais l'idée de ce livre m'est venue à peine étais-je entré dans cette demeure : d'emblée m'enchanta son caractère de mémoire vive, le fait même que je n'eus pas du tout la sensation d'entrer dans un musée, mais bel et bien celle de visiter les lieux en l'absence du compositeur, qui semblait ne les avoir quittés que pour un court moment. Tout (ou presque) en effet au Belvédère semble être resté en l'état, depuis la mort du compositeur en 1937 ; c'était sa volonté expresse : la maison, qui fut léguée tout d'abord à son frère Édouard Ravel (1878-1960), deviendrait ensuite la propriété de l'État à la condition que sa qualité de demeure fût intégralement préservée, jusqu'à l'emplacement des meubles et des objets. Aussi bien nous n'y trouvons pas ces horribles barrières ou cordons de protection, ces faux plafonds, ces panneaux didactiques, encore moins ces films projetés sur des murs de placo-plâtre "ornés" de surcroît de citations de l'auteur ou de représentations photographiques, qui habituellement défigurent les maisons d'artistes ou d'écrivains, comme celle de Jean Cocteau, à Milly-la-Forêt, hélas, et dans une moindre mesure, heureusement, mais pour combien de temps ? celle de Mallarmé, à Valvins. Au Belvédère, seule la cuisine a disparu : son mobilier a été remplacé par une modeste table qui sert de "billetterie", d'une discrétion exemplaire. Pour le reste, on n'a touché à rien : définition même de la beauté demeurée beauté.
J. de R. -. Avez-vous conçu votre livre comme un guide de visite ?
F. T. -. Oh non, même s'il est vrai que je présente la maison pièce par pièce et que j'invite pour finir à rejoindre le jardin, à travers un parcours photographique ponctué de notes. Mais ce n'est pas un guide, dans la mesure où c'est seulement mon regard qui a suivi ses préférences, voire ses caprices, et que le livre ne se prétend nullement exhaustif quant au contenu de la maison. De plus, je ne retrace pas son histoire, je fais seulement allusion à la vie du musicien dans ces lieux, que je décris et tente de faire parler. Si la demeure est un livre subjectif, amoureux même, il est issu d'un véritable coup de foudre pour le lieu, lequel fut favorisé il est vrai par mon admiration pour la musique de Maurice Ravel, toute sa musique, que j'écoute très souvent, qui m'accompagne et me nourrit ; je serais extrêmement peiné si je devais m'en priver.
J. de R. -. Qu'est-ce que ce livre, dès lors ?
F. T. -. C'est une promenade, c'est un rêve dans un lieu matériel, prétexte et illustration de notes autour du Lieu, entendu comme ce qui devrait être, comme ce qui manque, comme l'écart possible, circonscrit, hélas, à quelques rares demeures. Le Belvédère est unique, véritablement unique, véritablement rare : c'est un lieu chargé de souvenirs, un lieu "vibrant", une géographie sensible avec laquelle nous sommes enfin en sympathie avec le monde, un jour, une après-midi, une heure... Aussi bien il fait partie de ces lieux dont je puis dire : « C'est là que je voudrais vivre ». Et qui sait ? Peut-être ce livre sera-t-il une occasion de voyage pour l'un de ses lecteurs : j'aime à croire qu'au Belvédère j'ai laissé une pensée. Mon Lecteur et moi nous y retrouverions, au sein du souvenir, de l'intérieur de la demeure jusqu'au jardin.
Frédéric Tison, Si la demeure. L'auteur/Blurb, octobre 2014.
(Livre épuisé.)
19:14 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens | Tags : frédéric tison, jean de rancé, entretien avec jean de rancé, si la demeure, maurice ravel | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 09 avril 2014
Trois questions de Jean de Rancé (Entretien d'un soir)
(Je dédie ce petit entretien à mes Lecteurs & Correspondants.)
Jean de Rancé. -. Voici assez longtemps, cher Frédéric Tison, que nous ne nous sommes pas entretenus "publiquement" (sur ce blogue, je veux dire). Le temps manque, toujours, hélas, mais en attendant quelque heure plus propice à un long entretien, j'aimerais vous poser trois questions, si vous le voulez bien.
Frédéric Tison. -. Je suis là, vous le savez bien, cher Jean de Rancé !
J. de R. -. La première concerne la réception de vos dernières publications, Les Effigies (aux Éditions Librairie-Galerie Racine) pour commencer, puis votre traduction du Lai de l'Ombre de Jehan Renart, et encore "Les Herbes le soir", la carte que vous avez publiée, le peintre et graveur Renaud Allirand et vous, enfin le deuxième volume du Clair du temps, cette collection de photographies accompagnées de notes que vous avez auto-éditée récemment. Ces livres ont-ils rencontré un public ?
F. T. -. Je ne vous cacherai pas que leur diffusion est restée confidentielle, mais je suis très heureux de ces publications, et je mesure avant toute chose la chance qui m'a été donnée de pouvoir les partager. L'absence de relais "médiatique" n'en a nullement fait des lettres mortes ; au contraire, d'assez nombreuses personnes m'ont témoigné leur intérêt pour l'une ou l'autre de ces publications, et c'est pour moi l'occasion de dire que, malgré le pessimisme de rigueur qu'il est loisible d'observer parmi tous les contempteurs systématiques de la modernité, un archipel demeure possible, un échange, une réunion d'îles aimantes et attentives, îles qui savent bien que, depuis que le monde est monde, seul importe l'acte d'aimer, non son intention.
J. de R. -. Vous continuez d'enrichir votre blogue de toute sorte d'images et de notes, à un rythme régulier. Là encore, l'échange est-il réel ?
F. T. -. Bien sûr, j'augmente avec un grand plaisir ce blogue, et j'ai encore cette chance d'avoir des lecteurs réguliers et attentifs, même si nombreux sont ceux qui ne se manifestent qu'en privé. Ce blogue est également, vous l'aurez noté, une sorte de "laboratoire", et mes visiteurs, même discrets, demeurent bienveillants. J'en profite pour les saluer amicalement !
J. de R. -. Que vous a permis de comprendre l'acte de publier, et ainsi de soumettre à l'appréciation (ou l'indifférence) d'autrui vos "travaux" ?
F. T. -. Publier me permet de passer à autre chose, de tout simplement passer. Cela m'indique des chemins, et le regard que je pose sur mes publications est toujours critique, c'est-à-dire qu'il est fécond. Je ne peux pas connaître les regards de mes lecteurs, mais je les suppose en pensée... C'est ainsi que je deviens mon propre lecteur, en quelque sorte... Écrire, c'est aussi se voir écrire, et cela est très instructif (je dirais de même pour la photographie ou l'aquarelle). Ainsi, par exemple, mais cela m'est essentiel, je m'interroge sur la valeur, sur la beauté, sur l'"aura" de tel livre ou telle image : ces notions sont sans cesse bouleversées. Pour être plus précis : l'écueil (le r é c i f) est le joli, et même le beau, quand celui-ci n'est que souvenir ou récit personnels, qui ne diront peut-être pas le même beau à chacun... La tentation est grande et redoutable de donner du clair du temps, justement (le clair du temps étant non seulement l'instant des choses mais leur horizon, passé, présent et "avenir" rassemblés), la seule image choisie parmi les noirceurs du monde, quand celles-ci sauraient pourtant l'irriguer, ce monde, et le connaître tout en nous le faisant connaître. Le piège est le même que celui qui attend le poème, lorsque de la poésie il ne retient que le prisme du langage admirable... Il fallait tomber parfois dans ce piège ; c'était sans doute la condition de la poursuite du chemin. À la fin c'est toujours plus de profondeur qui manque, dirais-je, s'il faut aller plus loin que ce qui est seulement beau, ou plutôt que ce que je trouve beau... À la fin c'est chercher l'image qui demeure un Désir ; le mot qui demeure parole dans l'oreille et dans le cœur ; le visage d'encres et de couleurs.
22:24 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens, Sur la photographie, Sur le poème | Tags : frédéric tison, jean de rancé, entretien | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
mardi, 17 décembre 2013
Entretien avec Jean de Rancé (remise en ligne) - À l'occasion de la parution des 'Ailes basses', décembre 2010
(Cet entretien a paru pour la première fois en février 2011.)
Jean de Rancé -. Frédéric Tison, vous venez de publier un livre de poésie, Les Ailes basses, aux Editions Librairie-Galerie Racine [en décembre 2010]. Je vous remercie de m’accorder cet entretien, qui a lieu chez vous, dans votre petit appartement encombré de livres…
Frédéric Tison -. C’est moi qui vous remercie : aurais-je pu souhaiter un meilleur témoignage d’estime et de curiosité que votre sollicitation ? Vous me donnez là l’occasion d’une audience inespérée, extrêmement rare, même si, je dois bien vous le confier, je n’envisage guère un partage étendu au-delà d’un cercle très réduit d’amateurs…
J. de R. -. Vous évoquez là la situation navrante de la poésie en France, aujourd’hui.
F. T. -. Non, pas vraiment : je n’aurais guère l’outrecuidance de décrire la situation de la poésie à partir de la seule indifférence, très prévisible, et je dirais normale en ce qui concerne un auteur inconnu, qui a accueilli la parution de mon livre.
J. de R. -. Cependant, même les poètes célèbres d’aujourd’hui déplorent la raréfaction des lecteurs de poésie. Vous qui vous proclamez poète inconnu, vous n’êtes finalement pas dans une situation bien différente…
F. T. -. « Célèbres », vous y allez fort… Je me demande quels noms de poètes d’aujourd’hui pourraient citer la plupart de nos contemporains… Et peut-être ces poètes devraient-ils plutôt parler d’acquéreurs de livres de poésie que de lecteurs, dont le nombre doit être un peu plus élevé tout de même : les lecteurs de poèmes n’achètent pas nécessairement les livres… Et d’autre part, ces auteurs devraient-ils également parler de poésie contemporaine que de poésie. Et encore faudrait-il distinguer ceux qui lisent des livres entiers de poésie, et ceux, les plus nombreux, qui feuillettent ces livres et ne lisent jamais que quelques poèmes. Mais avant de poursuivre, j’aimerais préciser que je ne me proclame pas du tout « poète », et qu’il me semblerait du dernier ridicule de prétendre l’être. Si je puis l’être, c’est surtout à d’autres de le dire ; moi, je ne peux que tenter de le devenir, de tout mon cœur.
J. de R. -. Le sous-titre de votre livre est pourtant « Poèmes pour un Narrateur »…
F. T. -. Certes, et je ne vous cache pas que c’est avec quelque effroi que j’ai nommé ainsi mes essais… C’est en écrivant des poèmes que l’on peut espérer devenir poète, mais tout poème n’est pas poésie… D’abîme en abîme, tenter d’écrire des poèmes qui à leur tour tentent d’être poésie fait mesurer l’extrême difficulté de devenir un poète digne de ce nom…
Alors que j’écris « sérieusement » depuis plus de vingt ans, j’ai mis longtemps à oser écrire le terme « poème » concernant mes essais… Je ne dis pas cela avec affèterie, mais si j’ose écrire aujourd’hui que j’écris bel et bien (si j'ose dire !) des poèmes, que je présente tels dans Les Ailes basses, c’est parce que le nier serait désormais cette affèterie… Je préfère néanmoins parler de tentatives, d’essais de poèmes : le Poème étant toujours au-dessus du poème, à côté, en dehors, au haut, au loin, comment dire ? Le poème rêve qu’il est un Poème, et le Poème, peut-être, lointainement, rêve un poème qui soit lui… Et plus loin encore, hyperboréenne, il y a la Poésie… Il me semble que l’on retrouve cela dans la musique : la Musique est toujours l’horizon de la composition musicale qui l’indique et la rêve : Jean Sibelius en ses poèmes symphoniques rêve une voix toujours lointaine qu’il chante...
J. de R. -. Permettez-moi de revenir à la situation de la poésie, et de la poésie contemporaine en particulier, dans notre monde : le moins que l’on puisse dire est qu’elle n’occupe pas le devant de la scène.
F. T. -. Il me semble que la poésie, sous la forme que nous lui connaissons, la poésie livresque, la poésie imprimée dans les livres, a toujours été marginale, du moins si l’on entend par « situation de la poésie » sa présence immédiate, et apparente, dans la vie, le monde et les conversations.
J. de R. -. Il y eut tout de même des époques où la poésie était célébrée, où les mentalités lui concédaient davantage de place.
F. T. -. Certes, même si c’est là quelque peu idéaliser ces époques, me semble-t-il…
J. de R. – Je ne remonterai pas, bien entendu, aux temps où Pindare était écouté par les foules : c’était d’ailleurs là une poésie chantée, accompagnée d’une musique dont elle était inséparable, et bien différente de celle qui est écrite, et que nous trouvons dans nos bibliothèques… Et pourtant, il y eut des heures heureuses, à commencer par les troubadours, et puis les Grands Rhétoriqueurs, la Pléiade et l’école lyonnaise au XVIe siècle…
F. T. -. Est-il vraiment pertinent de comparer notre époque « démocratique » avec les époques antérieures ? Je comprends cependant votre question, car comme vous je suis nostalgique d’un temps passé, puis rêvé, quasi imaginaire, où d’ailleurs un homme comme moi, un homme de ma naissance, n’aurait sans doute jamais accédé à l’écrit ni aux arts, comme 70 ou 90% de la population selon les époques… Car non seulement les heures heureuses que vous évoquez furent, vous ne l’ignorez pas, des parenthèses, extraordinaires, et très limitées dans le temps – mais tout cela se passait, de surcroît, dans un milieu très étroit ! Certes, certes, Pierre Gringore… qui, au service des princes, fit entendre ses Mystères dans des églises au public nombreux… Mais les poètes du XVIe siècle œuvrèrent au sein d’une oligarchie à laquelle ils étaient liés, ou soumis, et qui les protégeait : comme les troubadours, comme Dante, comme Gringore, ils étaient rattachés à un pouvoir, à des mécènes qui, pour la plupart d’entre eux, se moquaient bien de leur poésie en tant que poésie, mais les employaient, en un dessein utilitaire, c’est-à-dire politique, à leur propre gloire. C’est Maurice Scève, à qui l’on commande la rédaction de l’entrée de Henri II et de Catherine de Médicis à Lyon en 1548, ainsi que les inscriptions en vers sur les arcs de carton dressés sur le passage du cortège royal. C’est Ronsard, à qui Charles IX commande, en décasyllabes s’il vous plaît, La Franciade. Libre à eux parallèlement d’écrire les trois mille et trois vers de Microcosme ou des poèmes sur une rose, sur lesquels seuls quelques esprits amoureux se poseront… Les poètes alors sont le plus souvent considérés comme des « décorateurs » de Cour, parmi bouffons et courtisans… On pourrait en dire autant de Racine, de La Fontaine… Et même si le Prince est lui-même un esthète, un amoureux des arts, je pense à Louis XIV par exemple, en subventionnant des poètes (et des peintres, des sculpteurs, des architectes, des jardiniers…) il œuvre uniquement à l’accroissement de son prestige personnel. Ce peut être d’ailleurs très bienveillant : c’est le mot que fait dire Sacha Guitry à Louis XIV dans Si Versailles m’était conté à propos de Jean Racine, compromis dans l’affaire des poisons, et que La Reynie souhaiterait dénoncer publiquement : le roi étouffe l’affaire Racine en disant « Je n’en vois pas l’avantage pour la France »… Et cependant ce n’est pas la poésie que le Prince sert, mais la poésie qui doit le servir, à travers les poètes ; vous conviendrez que c’est faire, à la fin, bien peu de cas d’elle… Et c’est toujours en creux la considérer comme un ornement, une fioriture, ce qu’elle semble être, parfois, bien sûr ; mais c’est là réduire infiniment ses pouvoirs, c’est la méconnaître gravement, c’est finalement ne lui conférer que le même sens vague et un peu mièvre qu’on lui octroie lorsqu’on évoque ailleurs, et gentiment, la « poésie d’un paysage », d’un style ou d’un visage… On exagère bien souvent la grandeur d’âme et l’amour de la beauté de la part des puissants – même parmi les temps anciens. Et c’est rétrospectivement que nous avons l’illusion que la poésie avait droit de cité parmi les hommes…
J. de R. -. Dans les temps "démocratiques" (pour faire vite), on pourrait tout de même citer la ferveur qui entoura les publications de Lamartine, de Hugo… Puis l’effervescence poétique, de Baudelaire à Rimbaud et aux premiers surréalistes… Ce furent bel et bien des Âges d’or, dégagés du mécénat et de l’intérêt des princes…
F. T. -. Lamartine ou Hugo bénéficièrent un temps d’une audience exceptionnelle parce qu’ils étaient étroitement impliqués dans les affaires politiques de leur temps : tout cela ressemble beaucoup à la ferveur quasi populaire que suscitèrent les poèmes de Char, Éluard, Aragon et d’autres durant l’Occupation et à la Libération, une ferveur qui brilla un instant puis fut soufflée comme la mèche d’une bougie. Quant à Baudelaire, à Mallarmé, aux surréalistes ensuite, le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ne touchèrent pas immédiatement le public… (Rimbaud est un cas à part, et il semble évident qu’il n’est pas aimé pour sa poésie : c’est une légende qui fut, qui est adorée, à l’instar des anciennes Vies de saints. Etiemble l’a bien montré, malgré les rodomontades de René Char à son endroit.) Voyons… Qui lisait Baudelaire en 1860 ? Quelques centaines de personnes tout au plus. Et Verlaine, en 1890 ?... Ne parlons même pas de Mallarmé… ou des surréalistes dans les années 1930… Et les surréalistes, « dégagés du mécénat » ?... Voyons voyons… Même s’il faudrait tout reprendre et nuancer, notamment à propos du changement de nature du mécénat, qui devint plus spontanément parfois un mécénat d’admiration, je ne vois guère d’époques heureuses pour la poésie, plutôt des cercles heureux où elle fut célébrée, presque secrètement.
J. de R. -. Concernant la visibilité de la poésie dans la société, ne trouvez-vous donc pas de différences avec notre temps ?
F. T. -. Si, bien entendu. Et les promesses de l’éducation de masse n’ont pas contribué à l’accroissement de l’importance de la poésie dans la vie quotidienne, bien au contraire…
Il faut toujours songer à la réception de la poésie, comme on dit à l’Université : le public contemporain des auteurs anciens était étroitement limité à une élite cultivée, ou tout du moins curieuse, et c’est aujourd’hui encore le cas : mais la nature de cette élite n’est plus du tout la même… Elle est devenue secrète, et elle n’est plus protégée par l’argent. Les lecteurs d’aujourd’hui, les amateurs de poésie, îlots épars dans la ville, sans pouvoir souvent, sans influence surtout, ont remplacé les Princes de l’Église ou ses moines instruits, les nobles ou les riches bourgeois, les mécènes… Leur nombre, proportionnellement à la population, n’a sans doute pas changé, à mon avis : mais leur pouvoir sur la société, sur les « mentalités », est absolument nul. La poésie ne rehausse plus aucun prestige… Aujourd’hui, ce sont plutôt les « plasticiens » et leurs hideuses œuvres qui bénéficient de la bienveillance intéressée des maîtres. Mais même si les pouvoirs en place, politiques et médiatiques, n’en parlent pour ainsi dire jamais, sauf pour l’affadir, la détourner, la ridiculiser, la poésie demeure une valeur. Et peut-être me trompé-je : le public étant virtuellement beaucoup plus vaste depuis l’école pour tous, plus vastes alors, peut-être, sont les rencontres possibles entre un lecteur et le poème… Mais ce n’est pas ce qu’on observe.
J. de R. -. La poésie, une valeur contemporaine ? Vous m’étonnez…
F. T. -. Une valeur, oui, mais secrète, mais confuse, mais maquillée, mais masquée, mais dégradée – ou plutôt secrète parce que confuse et dégradée.
J. de R. -. Comment serait-elle agissante, si elle est secrète ?
F. T. -. J’aime en percevoir les traces dans la vie moderne, où elle semble égarée, et où elle est mêlée en apparence avec ce qui n’est pas elle – où elle est aimée à la sauvette quasiment. Et l’époque est allée si loin dans la confusion, et l’époque est allée si bas, qu’il nous faut nous pencher désormais pour démêler, pour retrouver ne serait-ce que l’amorce de ce qui est elle – des bribes, des traces. Si vous prenez le métro parisien, vous êtes certainement déjà tombé sur cet écrit, prétendument poétique et humoristique, qui orne les parois des rames, à propos des journaux gratuits qui sont mis à la disposition des voyageurs :
Destin d'un journal abandonné
Attrapé à la volée,
Feuilleté en vitesse sur le quai,
Lu et relu, même l'édito,
Classique pour le journal du métro !
Mais sur le siège abandonné,
Glissé, tombé, piétiné, déchiqueté,
Eh oui, pour le pauvre journal, la poubelle
Eut été, ô combien, une fin plus belle...
Ou bien, sur ce texte intitulé « Amour fou » (ah !) dont j’ai photographié l’image, le vendredi 25 février 2011, dans le RER A :
« Les chewing-gums sont de grands romantiques.
Ces cœurs d’artichauts s’attachent très vite.
Mais les pauvres, rarement aimés en retour,
Cherchent désespérément le grand amour
Alors que la promesse d’un amour fusionnel
Est là dans tous les couloirs : c’est la poubelle ! »
J. de R. -. Oui, j’ai rencontré ces textes. Cela me fait penser à toutes ces publicités dont le slogan utilise la rime, ou bien, quand je prends l’autoroute, à ce texte de prévention sur les panneaux électriques :
« Toutes les deux heures
La pause
S’impose. »
F. T. -. Précisément ! Que ce soit dans la publicité la plus sotte et laide, dans le métro ou sur l’autoroute, il est très frappant que les slogans, sans être le moins du monde des poèmes, sans contenir aucune poésie, utilisent très fréquemment des procédés qui demeurent invariablement attachés à la poésie : celui du vers, et celui de la rime (même si celle-ci a disparu de nombre de poèmes contemporains) ou de l’allitération. Ces procédés persistent à « faire signe », à « faire sens », à indiquer en un mot : ceci est un poème parce qu’il s’agit de vers et que ceux-ci riment entre eux. Quoi qu’en disent nos experts en « poétique » et en circonvolutions linguistico-métaphysiques, cette approche est moins naïve qu’elle n’en a l’air, ou plutôt sa naïveté n’est nullement niaise. Elle est la conséquence d’une éducation de masse qui prétend initier à la poésie dès le plus jeune âge, et demeure le premier accès à la poésie en tant qu’écriture. Et elle rappelle une évidence : la poésie n’est nullement née pour décrire ou expliquer quelque chose, mais pour s’en souvenir et pour la chanter. Elle dit, dans et par le chant, par le rythme et le son du chant. Seulement, elle est vite écartée en tant qu’elle-même, dans sa « pureté », pour être remplacée par une caricature…
J. de R. -. En aparté, je ne sais pourquoi j’y pense soudain, ce genre de propos pourrait concerner certains politiciens qui se piquent de poésie…
F. T. -. Mais oui. Parmi nos politiciens, certains se rêvent tels de nouveaux Saint-John Perse, et ne sont pas poètes pour un sou, mais ils croient parler comme s’ils l’étaient : leurs ronflants hommages montrent, sans qu’ils s’en aperçoivent, qu’ils n’entendent strictement rien à la poésie – exactement à la façon des insupportables célébrations de la poésie de Rimbaud, naguère, en 1991. C’est touchant, ne trouvez-vous pas ? Ce l’est avant (ou après, c’est selon…) d’être navrant. C’est surtout, de la part de la caste à laquelle ils appartiennent, ordinairement égoïste et cynique, ou bien aveugle, le signe que même la classe dominante actuelle a vaguement conscience en son sein qu’il lui manque quelque chose, et à ce titre c’est à retenir. Cette récupération permet aux politiciens de se forger une image intellectuelle où la poésie est un faire-valoir : la rébellion poétique est instrumentalisée en faveur de ce qui la nie. C’est en ce sens que je dis que la poésie, même déformée, demeure une valeur – même dans une fausse aura « littéraire ».
J. de R. -. De là à y voir un signe de la vitalité de la poésie… À ce titre, vous pourriez évoquer les paroles du rap et du slam...
F. T. -. Je n’y vois nullement une quelconque vitalité ! Mais plutôt un désir latent de poésie, dont le sens semble perdu, tout du moins dont la signification est confuse, dont la réalité est ensevelie. Ces pauvres slogans, ces récupérations politiques et les faméliques textes du « rap » et du « slam », dont la pauvreté spectaculaire apparaît dès qu’ils sont privés du fond sonore qui les accompagne, quand ce n’est pas dès la première écoute, semblent percevoir la poésie comme un soleil minuscule, au loin, presque effacé, comme dans une brume opaque où poindrait à peine une tache floue et lumineuse… Ou bien, pour filer à l’envers la métaphore, il s’agit encore de l’allégorie de la caverne… À cet égard, nombre de poètes contemporains devraient être plus attentifs à cela, quand leur écriture prétend abolir tout rythme et toute musicalité… Mais n’allons pas trop vite…
Aussi bien cette mémoire qui transparaît à travers ces slogans et ces « slameries » ne se perçoit-elle pas comme mémoire ; elle n’en est pas moins éclatante. Elle montre que la poésie n’est pas morte pour nos contemporains, qu’elle est perçue, et, peut-être ? attendue comme un horizon, mais qu’on la masque, qu’on la déforme. Ainsi, dans un récent numéro de la Nouvelle Revue pédagogique, une publication destinée aux Professeurs de Lettres de l’enseignement secondaire, le thème de la poésie engagée est-il traité en mettant sur le même plan un poème des Châtiments et un texte d’Abd al Malik.
J. de R. -. Quelques intellectuels contemporains voient dans notre époque la fin programmée de la civilisation et de la culture. Cela pourrait expliquer, en ce qui nous concerne, la quasi disparition de la poésie de la sphère publique, la poésie dont il ne faut pas oublier que Hegel la considère comme la forme esthétique par excellence – partant, elle serait la première victime...
F. T. -. Mais j’ose timidement une interprétation, qui doit beaucoup à ma lecture comparée d’ouvrages politiques et historiques contemporains, sur certains points, tout en gardant à l'esprit que la nuance est toujours l'horizon le plus difficile... Notre notion de « culture », tout d’abord, est récente : la « culture », du mot latin cultus, culte, renvoyait à l’origine à un hommage empreint de sacré ; il s’étendit ensuite à l’agriculture et, plus tard, par extension, à l’élégance et aux raffinements des manières et de l’esprit. Enfin, au XIXe siècle seulement, il en vint à désigner le caractère intellectuel et esthétique d’une civilisation, mot lui-même nouvellement connoté, dans le sillage de l’émergence de l’idée de nation. Finalement ces intellectuels ne parlent que d’une époque révolue, quand elle n’est pas quelque peu idéalisée, circonscrite dans le temps à quelques privilégiés européens, le « Monde d’hier » magnifiquement évoqué par Stefan Zweig. Le phénomène de « l’effondrement culturel » ne peut apparaître que dans une société où l’idéologie démocratique, devenue en fait « société de consommation », a souhaité éduquer l’ensemble de ses membres. L’idée de progrès, depuis la Révolution, a notamment fait croire que l’ensemble des hommes, en bénéficiant d’un égal accès à la « culture », enfin s’élèveraient. Or cette « culture » n’est alors qu’un fruit détaché, elle se sépare de l’arbre qui la créait puisqu’elle se fonde sur elle-même, en se nommant elle-même telle : elle devient un « extérieur », id est un produit de consommation, détaché de la vie ; si l’art ou la poésie ne sont pas toute la vie, s’ils ne l’irriguent pas, s’ils sont considérés comme des loisirs, des « activités culturelles », ils ne sont rien : ni art ni poésie… L’idée de « culture » est étrangère aux civilisations cultivées – pléonasme par ailleurs, l’importance du Nom semblant de nos jours étrangère aux mentalités écoutées. Je n’ai rien contre le « loisir » ; mais le loisir distrait, il n’élève pas ; or le loisir est devenu « culture », au même titre que ce qui fondait une vie, et le loisir n’est pas nécessairement « culturel » : idée étrangère à notre époque où tout est mélangé. L’idée, la belle idée généreuse du commencement, a certes détaché le public lettré des seules classes dominantes, en permettant de puiser dans le peuple des êtres qui, sans une certaine conception de la démocratie, seraient restés à l’état honorable de paysans illettrés, un état qui était millénaire – bien sûr, les anciennes sociétés n’étaient pas aussi fermées sur elles-mêmes qu’on le dit, elles savaient s’ouvrir et s’épancher, sur, et vers leurs marges, et accueillir en leur sein l’élément étranger, mais elles ne le faisaient souvent que trop parcimonieusement. Cette situation inédite qui consiste à ouvrir à tous, magnifiquement, la boîte de Pandore du savoir et de l’« esthétique », du moins en théorie, s’est malheureusement heurté à une évidence : même si l’on offre à tous la beauté et les moyens de la percevoir, beaucoup n’en veulent pas, beaucoup n’y songent pas, beaucoup peuvent tout à fait se passer de poésie plus d’un jour… En somme, « l’effondrement culturel » est une conséquence inévitable de la démocratie, tôt ou tard ; cela n’infirme d’ailleurs pas la démocratie en tant que telle – mais cela la condamne en tant qu’idéologie quand elle veut étendre son champ d’action à tous les domaines de la vie. C’est terrible, évidemment, de le dire, mais il y a, en tous temps et en tous lieux, une élite de l’esprit, une élite pour la poésie, souple et ouverte selon, et qui ne dépend pas seulement des conditions historiques, comme il y a une élite de personnes dont la gentillesse est un trait de caractère, comme il y a une élite de personnes qui sont médecins. C’est peut-être moins choquant de prendre ce dernier exemple : imaginons une société qui se donnerait pour but de former l’ensemble de ses citoyens à la médecine, l’un des arts les plus ardus ; on voit tout de suite l’absurdité de la chose. Eh bien, c’est la même chose pour la poésie. C’est une élite qui invite avec l’amour… mais sélectionne toujours.
J. de R. -. Mais le lecteur de poésie n’est pas nécessairement poète ! tandis qu’il est vrai que l’art du médecin ne saurait être partagé par tous.
F. T. -. Le lecteur de poésie doit apprendre le langage de poésie, et c’est davantage que la seule éducation scolaire ne le permet ; c’est un apprentissage solitaire, aimant, douloureux ; tout lecteur de poésie est un autodidacte amoureux ; tout cela nécessite un effort qui, sans être comparable à celui de la médecine, sans doute, n’en est pas moins une sensibilité, avec sa part d’inné, sa part mystérieuse d’origine – et son amour. Et ce, même si je n’ignore pas qu’il est des situations sociales qui étouffent de nombreuses possibilités.
J. de. R. -. Comment se fait-il à votre avis que la poésie ne soit plus soutenue par les puissants, ou alors d’une manière caricaturale qui la dénature voire la vide de sa substance ?
F. T. -. Pour aller très vite, il semble que si l’art (au sens large) n’est plus une référence, c’est qu’il n’a plus de classe dominante qui le dicte ou le soutienne – et ne me parlez pas, de grâce, de l’art contemporain subventionné, cette hideuse dénaturation pour millionnaires incultes. Et puis, parmi nos « artistes consacrés », en voyez-vous beaucoup de généreux ? La plupart de nos écrivains contemporains fort chanceux, eux-mêmes peu généreux, pourraient faire leur cette parole sans doute apocryphe de la marquise de Pompadour à Louis XV : « Que voulez-vous ! Après nous le Déluge ! ». Ils nous ont abandonnés, tandis que le pouvoir, lui, a abandonné la beauté. C’est que – je précise que c’est une hypothèse – le pouvoir s’est détourné de la beauté parce qu’il n’en avait plus besoin pour son prestige. Restent ces îlots, toujours épris de poésie, qui ne sont que les éléments conscients d’un amour de la « culture », devenue culture (mais qui, donc, n’est pas « culture » pour ces îlots…), que toute l’entreprise des pouvoirs est de détruire, puisqu’elle s’opposerait aux profits si elle resplendissait (puisque désormais elle conteste ces pouvoirs), ou plutôt puisqu’elle ne lui est plus d’aucune utilité : ainsi l’on ne lit plus de livres, on ne regarde plus de peinture, on n’écoute plus de musique, mais on consomme des histoires, des images, des sons. Mais pour être consommées, il faut que les œuvres soient consommables ; elles se dégradent en produits. Les succès d’aujourd’hui sont des produits consommables, et l’on transforme ceux du passé pour l’être : on persuade qu’il faut avoir « fait » cette exposition, qu’il faut avoir lu le dernier « opus », comme ils disent, de tel écrivain. Les pitoyables « best-sellers » sans réelle écriture, la foule absurde dans les musées et la confusion entre musique et « chansons de variétés » pourraient s’expliquer ainsi. On transforme ce qui était l’accompagnement, l’armature, le sens d’une vie, en occupation, en divertissement, en loisir.
Une « scolie » de Nicolás Gómez Dávila me plaît beaucoup qui dit : « Le vice qui menace la droite est le cynisme ; celui qui menace la gauche est le mensonge ». C’est notamment renvoyer dos-à-dos, me semble-t-il, deux attitudes qui, devant la poésie, en l’occurrence, seraient : ici, La poésie ne peut qu’être réservée aux seuls initiés, et là : La poésie est communément partagée. C’est ici un élitisme, si mal nommé d’ailleurs, qui sévit avec morgue, vanité et égoïsme ; et c’est là une démagogie qui n’est pas elle-même exempte de mépris, ou d’aveuglement.
Ce que je dis n’est pas mépris pour le « peuple » dont je fais évidemment partie – je le précise, car même pour certains de mes proches je fais vite figure d’affreux réactionnaire ; il faut bien dire que les mots étant utilisés à tort et à travers en matière politique, aucun dialogue digne de ce nom ne peut se nouer. Mais la difficulté, quand on s’éveille à ces choses, est de maintenir la distance : il faut à la fois éviter l’écueil de la pensée prétendument dominante actuelle, pleine de pitié sans amour et de bons sentiments, et celui de la vanité, qui instrumentalise l’élitisme à son seul profit, avec l'indifférence.
J. de R. -. Comment, selon vous, résumer le problème de la poésie aujourd’hui ?
F. T. -. En disant peut-être que la crise de la poésie est récurrente, mais que ce problème est mal posé. On dirait que la poésie n’a plus droit de cité, que tout le monde s’en moque, à commencer par les médias, ce qui est vrai en l’occurrence, mais depuis quand les médias, ces nouveaux Salons, sont-ils le reflet du monde, de tout le monde ou des « individus », c’est-à-dire, pour le dire plus bellement, des personnes ? Je suis certain de n’être pas le seul à n’avoir presque jamais lu la prose des journaux majoritaires, écouté une émission de radio ou regardé la télévision sans me sentir parfaitement étranger à tout ce qui se disait, à la manière dont on le disait, aux choix qui présidaient aux sujets abordés… Beaucoup de médias sont bien souvent l’expression d’une caste étrange, sorte de Martiens venus commenter, de leur vaisseau, sans s’être jamais aventurés sur son sol, et sans la précision de l’entomologiste ou de l’historien, les nouvelles de la Terre… Or je suis certain que si l’on demandait au hasard à des passants ce qu’ils pensent de la poésie, l’on verrait que la poésie est tenue en haute estime par nombre d’entre eux, surtout la poésie du Passé, comme disait Éluard, bien entendu, mais aussi son « idée », ce qu’elle représente, même naïvement : la beauté, le rêve, l’émotion devant et à travers la langue. Mais bien souvent on ne demande rien aux passants. Et ceux qui parlent, les fameux « sondés », semblent toujours les mêmes, qui vont dans le sens d’une Opinion créée de toutes pièces… Il est vrai aussi, hélas, que les médias créent cette opinion qu’ils pensent analyser, et que leur bêtise agit par contamination…
Il est possible par ailleurs que l'état d’inculture que nous observons aujourd’hui soit consciemment organisé : à quoi servent des lecteurs de poésie, à quoi servent des poètes dans une société de consommation ? Ils la desservent au contraire… La poésie est une subversion subtile, or notre époque ne peut digérer que des subversions tapageuses, puisqu’elle prétend être l’héritière des révolutions démocratiques…
Or je suis persuadé qu’il existe d’assez nombreux lecteurs potentiels – qu’il en existe tout du moins un nombre constant. Encore, me dira-t-on, faudrait-il qu’ils aient le temps de s’y consacrer – même si, répondrai-je, l’on a toujours du temps pour ce que l’on aime... Donc, bien sûr, ce temps, seuls le prennent ou le volent les amoureux fous de la poésie, dont le modèle ne doit pas faire mépriser la masse de ceux qui n’en font pas partie mais qui accueillent favorablement le poème et la poésie en tant que rêve, en tant que beauté et réflexion sur la vie.
J. de R. -. N’exagérez-vous pas l’intérêt des hommes pour la poésie ?
F. T. -. Je ne le crois pas. Ma « thèse » est que les hommes aiment la poésie, mais que leur rassemblement consensuel la détruit au nom de la haine utilitaire. Que l’existence, que le monde soient dans la poésie, soient pétris de poésie, chaque homme le sait profondément, mais la société floue, le rassemblement des êtres, la foule, tout ce qui réunit vaguement, tout ce qui est moyen, médiocre, consensuel, les journaux, la télévision, une immense partie de l’internet aujourd’hui, tout cela hait la poésie, déteste tout ce qu’elle représente… non, représente n’est pas le bon verbe, tout ce qu’elle est : la solitude, l’espace, la marge, la nuit, le vent, un sentier…
Tout cela hait la poésie et entraîne les hommes vers la médiocrité, très loin d’elle, selon une pente hélas plus facile à suivre. Le plus curieux est que certains êtres médiatiques, « journalistes », et « intellectuels », incarnent parfaitement cette haine tranquille, douceâtre, le plus effarant est qu’ils puissent être à ce point les porte-parole de cette façon, laide à pleurer, d’être au monde, et qu’ils la répandent dans l’ « Opinion », cette horreur marécageuse et truquée issue de ces ridicules « sondages » d’où l’on ne retire que l’impression navrante que les pensées des hommes sont plus soumises au vent de l’imbécillité qu’une girouette rouillée, tandis que chaque homme, lui, demeure ouvert à la poésie, s’il veut bien écouter ce qui est en lui, s’il veut bien voir, s’il veut bien faire taire aussi ce qui l’environne artificiellement. Qu’un homme écoute, qu’un regard se pose : cela suffit pour le commencement de la poésie. Le coquelicot est l’image même de la poésie : au bord des chemins, dans leurs marges, sauvage, élégant, rouge pur, tout simple, divinement simple, il meurt en quelques instants dans un vase si vous le cueillez et l’y plongez ; il ne demandait que l’œil amoureux, dans son champ, parmi les herbes folles, dans l’ornière…
Le monde social hait la poésie, mais quelques uns – et quelqu’un – l’aiment – passionnément. Le monde dit non à la poésie, croit qu’il n’a pas besoin de poésie, pas besoin de vers – mais quelqu’un dit « Oui ». Et l’amour dit toujours « Oui »… Et ce « Oui » est délibérément, je le maintiens, occulté.
J. de R. -. Plus prosaïquement, vous n’ignorez pas que l’édition de la poésie est en crise. Les rares éditeurs qui ont encore le courage, l’énergie et la volonté d’éditer encore de la poésie ne peuvent que se plaindre de la raréfaction des lecteurs, et, partant, des ventes de leurs livres.
F. T. -. Bien sûr ! Et l’on dit même, parce qu’on le sait, que nombre de poètes ne lisent pas leurs « confrères » contemporains… ce qui fait chuter encore, et considérablement, le nombre des lecteurs ! Cela dit, toute la littérature contemporaine de qualité subit cette raréfaction de lecteurs « littéraires ». Mais j’évoquais, après vous, la « situation de la poésie aujourd’hui » : comme toujours, avant ce jour d’hui dont vous parlez, la poésie est occultée, mais elle n’est pas dormante.
J. de R. -. Cependant, j’y reviens, ne constatez-vous pas que presque plus personne ne lit de la poésie…
F. T. -. Presque plus personne, dites-vous ? Mais qu’en savez-vous exactement ? La poésie n’a jamais donné de vraie joie qu’à certains esprits épars, n’a jamais été la trame d’une existence que pour un certain nombre de personnes, auteurs ou lecteurs, solitaires, et îlots, déjà – selon le temps, selon les circonstances. Mais, je le répète, il y a sans doute davantage de lecteurs de poésie qu’on le dit ; sans doute ces lecteurs se tournent-ils davantage vers des « valeurs sûres » consacrées par le temps parce qu’ils ont le sentiment de se perdre dans la masse des publications confidentielles contemporaines – je les comprends, je suis comme eux un grand naufragé. Pour découvrir et lire la poésie d’aujourd’hui, il faut vouloir se frayer un passage à travers des ronces plus épaisses et plus meurtrières que celles qui encerclent et scellent le château de la Belle au Bois dormant. Mais dans le fatras, perdus, négligés, des poèmes scintillent encore. Ce n’est pas parce que le monde abomine la patience qu’il parvient à détruire tous les lecteurs…
J. d. R. -. Selon vous, c’est presque une conjuration contre la poésie qui est à l’origine du phénomène.
F. T. -. La poésie n’a pas la place réelle qui la rend indispensable à ceux qui l’aiment et l’appellent, cette place qui lui revient, et qui est peut-être toute la place, l’essentielle. Et l’aurait-elle, cette place qui lui appartient, que des forces inconnues surgiraient qu’il faudrait selon certains brider, et que tous les pouvoirs en place, et oui, conjuratoires, voudraient détruire…
J. de R. -. N’est-ce pas une facilité que de montrer du doigt les médias ?
F. T. -. Ah les médias… Vous avez raison, c’est devenu une habitude de les vilipender, mais c’est bien souvent à juste titre : on pourrait me rétorquer que la presse est plurielle, mais à part quelques voix étouffées, ou vite récupérées, tout le monde dit la même chose… Il n’y a guère de différence, en matière d’absence de générosité, entre tel journaliste prétendument frondeur, et les animateurs des Guignols, l’émission prétendument subversive de marionnettes. Ceux-ci expriment le pire de la pensée « de gauche », et jouent le rôle des anciens bouffons du roi, dans l’adoubement bien-pensant des applaudissements rigolards – le roi, en attendant, maintient sa poigne de fer : les vraies contestations sont lettre morte. Celui-là, très à l'aise dans le milieu qu'il pourfend, se veut le porte-parole d’une pensée qualifiée « de droite réactionnaire », pour faire vite, mais il sombre dans l’excès inverse de ce qu’il dénonce, condamnant sa pensée à n’apparaître que comme une « provocation » vite cataloguée, et, partant, parfaitement inefficace. Ce sont là les deux faces d’une même caricature. Mais personne à la fin n’aime ! ni, mais c’est la même chose, ne fait. (Et je ne suis pas le dernier à déceler en moi cette insuffisance…)
J. de R. -. Mais alors, face à ce constat désespéré, que manque-t-il ?
F. T. -. Revenons au fait qu’il y a toujours eu des îlots. Il manque seulement, si j’ose dire, mais c’est capital, aujourd’hui – et là je vous concède que la situation est assez neuve – il manque l’archipel : cet archipel qu’une certaine nostalgie, peut-être, ou peut-être même est-il une illusion, mais je ne le crois pas, m’enjoint d’observer dans des temps récents encore, ceux du monde d’avant la Seconde Guerre mondiale ; la lecture du magnifique Monde d’hier, de Stefan Zweig, tendrait à confirmer en moi cette impression. Où sont donc les écrivains généreux, les grands seigneurs curieux, aujourd’hui ? Comment se fait-il qu’il soit si difficile de créer des réseaux d’amitié littéraire ?
L’archipel des îlots, oh oui, c’est cela qui fait défaut… Cette communauté des îles est d’abord mise à mal en raison d’un manque de diffusion : c’est un lieu commun que de constater que jamais le monde n’a prétendu être aussi « informé », mais que ce qui constitue la matière de cette information, non seulement est simpliste, mais est extraordinairement lacunaire, relativement à sa prétention d’être « global » et « instantané » ; en dehors des guerres et des faits politiques, qui d’ailleurs ne sont jamais analysés en profondeur, des nouvelles aussi dérisoires que la victoire d’une équipe sportive ou l’énième sortie d’un gadget technologique font la Une des journaux, ce qui n’est pas nouveau, mais ce faisant éclipse ce qui reste et désormais l’anéantit ; la mort d’un grand compositeur ou la parution d’un livre littéraire important laissent de marbre la plupart des médias décideurs – c’est en ce sens qu’il faut les comparer aux anciens Salons où tout se faisait et se défaisait. La manie commémorative rappelle l’énième anniversaire de la parution de tel disque de variétés, mais néglige en 2007 le cinquantenaire de la mort de Sibelius ou, en 2008, les vingt ans de la mort de Guy Hocquenghem. Jean Bottéro, l’un de nos plus grands historiens, l’un des plus grands esprits qui fussent, est mort en 2007 dans l’indifférence médiatique. L’explosion du « copinage » aboutit d’autre part à une sélection de l’information au profit des cooptés et au détriment des « sans-grades », ceux-ci rassemblant de plus en plus des autodidactes éclairés. Chaque homme lisant Baudelaire ressemble alors à un naufragé dont le monde, dans sa magnanimité lointaine, a organisé l’exil : parlez de poésie si vous le voulez, mais ne nous en parlez plus, nous avons mieux à faire, à dire, à aimer.
Mais cela sans doute ne décrirait qu’une écorce. Les gens ne sont pas aussi imbéciles que les sociologues et les intellectuels, tous ceux que l’on désigne par « penseurs de la modernité », se le figurent. Ceux-là même, comme chacun, sont enfermés et n’ont plus le temps d’écouter : ils ne prennent ce temps, un peu comme les amitiés qui s’étiolent faute de curiosité réelle. Des perches sont tendues dans le vide, personne ne les saisit, à commencer sans doute, hélas, par nombre de poètes eux-mêmes. Les partages sont brefs, aléatoires, inconstants, et chacun éprouve tôt ou tard douloureusement l’impression de lasser...
Malgré les quelques épisodes heureux dont nous avons parlé, et que je me suis d’ailleurs permis de nuancer, et hormis les temps homériques ou bibliques – c’est-à-dire quand la poésie est collective, ou du moins quand son résultat l’est –, la poésie a toujours été souterraine, elle s’est déroulée dans l’ombre, elle a toujours conservé la trace de la nuit dans le plus étincelant des jours… On pourrait même comparer sa situation à celle de chrétiens qui jamais ne seraient sortis de leurs catacombes, tout en maintenant intacte leur ferveur. Il est vrai que les ténèbres sont particulièrement épaisses de nos jours, ou semblent telles à des esprits amoureux du poème et en recherche de poésie.
Le mot de conjuration peut sembler excessif, et pourtant… La fameuse phrase de Bernanos relative à la conspiration moderne contre toute vie intérieure rejoint la constatation de l’absence de la poésie dans l’actuelle société des hommes. Ne percevez-vous pas la haine qui court par le monde à l’encontre de la poésie ? Je ne parle évidemment pas de ces belles et salutaires haines, de ces colères magnifiques ; mais de la petite haine, pourtant puissance très agissante, destructrice, mélange de mépris, d’indifférence et de peur ; l’expression de son visage aujourd’hui est une indifférence, parfois feinte, mais le plus souvent inculte, face à la poésie.
J. de R. -. Dans quelle mesure la faute en reviendrait-elle également aux poètes eux-mêmes ?
F. T. -. Écrire est une solitude qui se creuse elle-même, et tel Narcisse le poète fasciné tombe dans une Eau où il meurt au monde. Et il n’y renaît pas souvent fleur…
Aussi bien, où serait la générosité du poète ? Comment une poésie aussi savante, aussi belle, aussi exigeante que celle de Baudelaire ou celle de Verlaine parvient-elle à être populaire ? C’est bien entendu le fait de l’école, qui familiarisa la masse des élèves avec ces poètes. Mais c’est aussi que ces poètes sont généreux, ils aiment et savent tout de la vie… Si la poésie « faite par tous » est une sottise, la poésie « pour chacun » est un devenir sans cesse recommencé… Je n’ignore pas qu’elle n’est pas pour autant lue, à commencer par celle des poètes « populaires » eux-mêmes…
Or le poème, de la hauteur de sa forme, s’incline jusqu’au lecteur pour l’élever à sa suite s’il le souhaite. Le poète, s’il n’est à la fois hauturier, lointain et aimant, qu’a-t-il à dire ? Publier, c’est vouloir offrir.
J. de R. -. Peut-être le monde a-t-il contraint les poètes à se cacher…
F. T. -. Ah non. On n’empêche pas réellement de parler (si l'on prend, certes, quelques précautions...). Le monde empêche d’écouter, c’est bien plus retors. Or la poésie est là, elle est toujours là, et pour commencer dans ce visage qui vous sourit, dans ce poète qui vous offre son livre, comme dans ce passant dont la rencontre ne s’achève pas en solution mais en devenir rêvé, elle est partout, partout !
J. de R. -. « Publier, c’est vouloir offrir », dites-vous… N’y entre donc aucune part de vanité, je veux dire la volonté même inconsciente de se distinguer du lot, et de se montrer ?
F. T. -. Oh sans aucun doute… Mais pour moi ce n’est pas en cela que réside le premier désir – ni l’ultime... Publier, pour moi, mais c’est sans doute naïf, et tant pis !, c’est lutter contre un immense sentiment ancien de solitude, c’est offrir pour partager. Je n’ai jamais écrit pour gagner de l’argent, je n’ai aucunement l’ambition d’accéder à la célébrité, personne ne m’a jamais commandé le moindre texte. Cela ne fait pas de moi un meilleur auteur qu’un auteur subventionné, bien entendu. Le poète Ossip Mandelstam, dans La Quatrième Prose, oppose volontiers les œuvres « permises » à celles qui ne le sont pas. Son ton est polémique : « Toutes les œuvres de la littérature mondiale, je les partage en deux groupes - celles qui sont permises, et celles qui sont écrites sans permission. Les premières – c’est du vomi, les autres – un peu d’air qu’on dérobe ». Il n’est pas besoin d’aller jusqu’à cette violence, naturellement, et le propos peut paraître outrancier : il est nombre d’œuvres « permises » qui sont des œuvres essentielles, d’ailleurs toutes les œuvres du passé ont été « permises » par l’argent, le pouvoir, les réseaux, etc. La Divine Comédie n’en est pas moins étincelante si on la replace dans le ridicule contexte des mesquins conflits entre Guelfes et Gibelins, qui pourtant l’ont permise et fécondée, et lesquels n’ont une aura nostalgique que parce qu’ils sont éloignés dans le temps, tandis qu’ils ne sont guère que la version médiévale des sordides calculs de nos hommes d’État… Mais l’assertion de Mandelstam convient assez bien à notre temps, pour son caractère de vigilance : depuis que l’auteur peut s’affranchir d’un mécène pour écrire et publier, il écrit plus librement. C’est notre temps (au sens très large – depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours) qui permet Mallarmé, Nouveau, Ponge, Gracq, Augiéras… Bien sûr il y a toujours de grands seigneurs rentiers ou très chanceux, Proust, Yourcenar, Rilke, Bonnefoy, Quignard… Mais tous ces auteurs se partagent également le livre.
J. de R. -. Notre temps, d’après vous, serait donc paradoxalement une chance pour la poésie, mais que le monde ne saisit pas…
F. T. -. Eh oui, c’est un peu cela. Des îlots, nul archipel ne réunit leur pouvoir. Ceux qui pourraient, par le truchement de l’influence, et de l’argent – car c’est toujours un peu cela –, créer les conditions de cet archipel en tendant la main ne le font pas, et ceux qui solitaires tendent la main ne rencontrent que l’absence.
Ce ne sont pas là des considérations désespérées, cependant. Même si l’on idéalise certaines époques, la poésie a toujours été vaguement négligée. Il faut peut-être à la fin lui souhaiter cette perte, où elle ne cesse de resplendir ; car on pourrait même avancer, selon une hypothèse optimiste, que c’est là la condition de son être. La poésie est en marge, est marge. Un monde où la poésie serait convoquée pour ce qu’elle est n’aurait plus besoin d’elle, car la fin de la poésie est en elle-même et en son rêve à la fois. Quand la politique « pense » la poésie, c’est le signe même qu’il ne s’agit pas de poésie. Les temps modernes ont déjà décrété un ministère de la Culture, et vous conviendrez qu’il ne serait pas de plus grande hideur qu’un ministère de la Poésie !
Quelle serait la réponse à la question « Avez-vous déjà croisé dans la rue le visage de la poésie ? »… Il n’est d’autre réponse à mon avis qu’un « Oui », qui résumerait de la poésie sa fragilité, et son avenir parmi les hommes.
18:51 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens | Tags : frédéric tison, jean de rancé, entretien, poésie, les ailes basses | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
vendredi, 06 décembre 2013
Entretien avec Jean de Rancé - Sur "Le Lai de l'Ombre"
Jean de Rancé. -. Voici, cher Frédéric Tison, que vous publiez – cette année 2013 vous est décidément propice ! – une nouvelle traduction du Lai de l’Ombre, de Jehan Renart, dont vous avez confié l’impression aux soins de Lulu.com, l’imprimeur en ligne. Pourriez-vous nous parler de ce livre ?
Frédéric Tison. -. Très volontiers, cher Jean de Rancé. Le Lai de l’Ombre est un magnifique conte courtois, en vers, écrit en ancien français, vers l’an 1222, par quelqu’un qui se fait appeler Jehan Renart : ce dernier est sans doute un homme haut placé, peut-être un évêque comme vous le lirez dans mon introduction, ne désirant pas publier, sous son vrai nom, un texte qui comporte quelques passages un peu lestes, sans parler d’une liberté de ton fort éloignée des évangéliaires et des psautiers. Il s’inscrit dans la belle tradition – laquelle était, oui, déjà une tradition, au XIIIe siècle – du fin’amor, l’amour pur, l’amour chevaleresque entre une belle dame sage et un chevalier de rang inférieur, cet amour courtois qui inspira tant de songes, d’images et de désirs. Jehan Renart joue avec cette tradition, il l’aime, et il la respecte, mais il lui insuffle un air nouveau, avec l’ironie et le rêve. Je connaissais ce lai depuis quelque temps déjà, mais je l’ai relu ces dernières années, tandis que j’écrivais les poèmes des Effigies, mon dernier livre, dont il a inspiré, pour une part, l’un des poèmes : quelqu’un, dans Les Effigies, a lu Le Lai de l’Ombre, et il m’a semblé plaisant d’en proposer une traduction nouvelle en un livre qui serait alors l’un des « satellites » du livre de poèmes, à l’instar du carnet de photographies mien que nous évoquâmes naguère.
J. de R. -. Un autre satellite !
F. T. -. Je ne saurais réduire le bel ouvrage de Jehan Renart à la qualité de satellite de l’un de mes propres livres, naturellement, mais ce Lai de l’Ombre trouve en moi des échos si profonds qu’il m’aurait semblé dommageable de ne pas les écouter. J’aime beaucoup trouver des passerelles entre les livres, entre les siècles. Songez à Borges, qui, dans ses Fictions, imaginait un auteur contemporain ayant influencé un auteur du passé…
J. de R. -. Vous proposez là de ce texte une nouvelle traduction de l’ancien français. Pardonnez-moi cette question, mais quel médiéviste êtes-vous pour vous être lancé dans une telle entreprise ?
F. T. -. Votre question est légitime. Je ne suis pas du tout un « médiéviste », ni un professeur d’ancien français, mais, il y a bientôt vingt ans, j’ai, à l’Université, étudié durant trois années cette langue, ce qui m’a beaucoup plu, et, depuis, j’ai plaisir à lire dans le texte des écrits des XIIe et XIIIe siècles, armé, naturellement, d’un lexique et d’un dictionnaire ; je ne parle pas couramment l’ancien français, bien sûr ! Je sais cependant frayer mon chemin à travers ces ronces françaises. Et puis, m’étant piqué d’éditer, naguère, des textes français du XVe et du XVIe siècle (Charles d’Orléans, puis Maurice Scève et Étienne Dolet), je ne pouvais pas, en faisant cela, ignorer l’ancien français qui précédait le « moyen français » dans lequel ces textes étaient composés. La mutation capitale, en langue française, a lieu au XIVe siècle ; il faudra que je m’attelle un jour à la traduction d’un écrit de cette époque, peut-être un poème de Jean Froissart, je ne sais, dont seules les chroniques sont connues du public cultivé d’aujourd’hui.
Pour revenir à Jehan Renart, si je ne prétends nullement, je le répète, être un spécialiste de la langue dans laquelle son beau lai a été écrit, j’en sais suffisamment pour ne pas me méprendre, et pour prétendre en proposer une traduction fidèle, dans la mesure du possible, et nouvelle, dans la mesure où cette traduction n’est ni « versifiée » (je n’aime pas beaucoup ces versions assommantes qu’on lit trop souvent, ces alinéas sans grâce ni rythme, fades, hagards, désossés, qui ressemblent trop à certains pseudo-poèmes contemporains) ni « arrangée » (il s’agit de ces versions qui élaguent l’original, et en gauchissent la trame et l’esprit en prétendant l’adapter au goût moderne).
J. de R. -. Pourquoi, de manière générale, éditer ces « textes rares et oubliés » ?
F. T. -. J’ai le souci, tout simplement, d’exhumer des textes qui me sont chers, et dont j’ai pu regretter l’absence, jadis, des librairies, voire des bibliothèques. Allez donc trouver une autre œuvre de Maurice Scève que la Délie, ou dénicher Le Second Enfer d’Étienne Dolet, et l’ensemble des Ballades du fameux concours de Blois organisé vers 1457 par Charles d’Orléans… Il m’a semblé souhaitable, d’autant que la démarche éditoriale que je me suis proposé est passionnante, de les proposer de nouveau. Je les accompagne, d'autre part, de petites notes qui sont autant de réflexions miennes sur le poème, l'image et le temps.
J. de R. -. Si ces textes sont oubliés aujourd’hui, n’y a-t-il pas une raison à cela ? Pensez-vous vraiment que ces éditions nouvelles trouveront un public ?
F. T. -. Tout d’abord, je pense que ces textes sont d’admirables écrits, et je propose seulement de les faire découvrir. Libre à quiconque de s’y pencher comme je m’y suis penché, ou de passer son chemin.
Il ne s’agit pas, ensuite, d’éditer à tout prix n’importe quel texte rare – il en est de rares et d’ennuyeux, justement oubliés – mais au contraire de déceler les tombés des rayonnages, comme on dit de personnages de l’histoire pourtant fascinants qu’ils sont tombés des dictionnaires, et d’injustement tombés : la tâche est immense, et je ne fais là que prendre part, à mon sens, à ce qui prendra de l’ampleur ; je ne suis qu’une petite fourmi, solitaire et vaillante. Je fais là pour des auteurs anciens ce que devraient faire tous les éditeurs de métier pour les écrivains de notre temps : s’attacher au texte, non à la connaissance personnelle de l’homme, tenter de trouver, ou retrouver des voix.
Évidemment, mon entreprise manque de relais ; je suis cependant certain qu’elle trouverait un écho auprès de personnes qui n’en sont pas informées. Il est simplement dommageable que je n’aie pas de moyen de diffusion autre que ce blogue et l’annonce ici ou là, sur quelque réseau social. Comme tous mes livres, mes petites éditions sont des bouteilles à la mer.
J. de R. -. Pourriez-vous nous résumer Le Lai de l’Ombre ?
F. T. -. Surtout pas ! Je laisse au Lecteur la joie de découvrir ce conte exquis, et sa fin délicieuse… Je répèterai ce que j’ai écrit sur la quatrième de couverture : « En dévoiler la fin [du Lai de l’Ombre], sinon l’intrigue, dès la quatrième de couverture, serait une trahison pire que toutes les traductions possibles ».
J. de R. -. Comment donner à nos lecteurs l'envie de découvrir votre nouvelle traduction du Lai de l'Ombre ?
F. T. -. Ma parole est une invitation, cependant elle n'est pas prescriptive ! Je puis seulement dire : Cela est magnifique, voici ce que je vous propose. À vous de voir.
Songez également qu'en 1222, 1 ou 2% seulement de la population (le cercle très étroit des lettrés, dans les monastères, et celui, moins cultivé, des châtelains et de leurs cours, où, à défaut de toujours savoir lire, on pouvait entendre réciter quelque conte) avaient accès au Lai de l'Ombre et étaient susceptibles de s'y intéresser. Aujourd'hui, en 2013, même s'il a changé de nature sociale, le pourcentage de lecteurs potentiels, à la fin, demeure le même. Ne trouvez-vous pas la coïncidence amusante ?
Jehan Renart, Le Lai de l'Ombre. Édition de Frédéric Tison (présentation, transcription de l'ancien français, traduction, notes, illustrations). Lulu, 2013. 168 pages.
*
06:50 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens, Une petite bibliothèque | Tags : frédéric tison, jean de rancé, entretien, le lai de l'ombre | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
dimanche, 27 octobre 2013
Entretien avec Jean de Rancé – Sur un carnet de 76 photographies
Jean de Rancé. -. Parallèlement à la parution, aux Éditions Librairie-Galerie Racine, le 8 octobre dernier, de votre dernier livre de poèmes, Les Effigies, je note la parution, peu après, d’un livre de photographies qui porte le même titre. Pourriez-vous, cher Frédéric Tison, éclaircir les raisons qui ont présidé à l’élaboration de ce « carnet de photographies » ?
Frédéric Tison. -. C'est, cher Jean de Rancé, un livre « satellite » du livre de poèmes, et je précise tout d’abord qu’il s’agit là, contrairement au livre de poèmes, d’une auto-édition, qui n’a donc pas été sanctionnée par la lecture préalable et l'approbation d’un comité d’édition : c’est le livre d’un amateur. Depuis quelques années, la photographie a pris une grande place dans ma vie, et si j’ai commencé à les sélectionner pour les présenter d’abord sur mon premier et deuxième blogue, ici même, j’ai souhaité poursuivre l’aventure à travers des albums imprimés tels que les volumes du Clair du temps. L’idée de composer un livre de photographies qui fût le « satellite » d’un livre de mots m’est venue alors que j’écrivais les premiers poèmes qui composent Les Effigies : certaines des images que je photographiais en dehors du temps de l’écriture me semblaient, non pas les illustrations des poèmes (lesquels n’en appelaient nullement), mais leurs ombres, leurs échos, et peut-être même leurs autres possibles. Par un phénomène assez curieux, le poème et l’image photographique pouvaient en quelque sorte s’échanger, de façon spéculaire, sans que l’un ou l’autre en soient altérés. C’est pourquoi le livre de poèmes n’avait pas besoin d’être illustré (si j’excepte la photographie de couverture) : il contient ses images dans le lacis des mots ; et c’est pourquoi le carnet de photographies ne cite aucun poème de l’autre livre : chaque image qu’il contient suppose un mot qui n’est pas lisible.
J. de R. -. Pourtant, votre carnet contient bel et bien du texte : je parle de ces annotations, éparses tout au long des pages, sur la photographie, de ces sortes d’« aphorismes » que vous nommez ailleurs « minuscules ».
F. T. -. Précisément : ce sont des notes sur la photographie, sur mon expérience de la photographie d’amateur plus exactement ; ce ne sont nullement des éclaircissements qui seraient liés aux poèmes, des commentaires. Le carnet n’illustre ni n’explique le livre de poèmes. Le fil qui les relie est fort ténu, il est de l’ordre du rêve : le livre rêve le carnet et le carnet rêve le livre.
J. de R. -. Votre carnet est tout de même le « satellite » du livre de poèmes : il en est donc dépendant, alors que Les Effigies ne sont pas dépendantes des photographies.
F. T. -. Oui, vous avez raison. Cela n’empêche pas le carnet d’être un livre à lui seul, qui peut se parcourir sans qu’on ait connaissance des poèmes. Mais il est vrai qu’il n’existerait pas sous cette forme sans le livre de poèmes, c’est la raison pour laquelle j’en parle comme d’un « satellite », et qu'il porte le même titre.
J. de R. -. Les photographies de ce carnet sont très disparates : sous forme de grandes vignettes, voici quelques paysages, quelques beaux sites, mais aussi des détails, quelques fragments de tableaux, de sculptures, et surtout des « morceaux de réel », eaux, bois, lueurs, ombres, couleurs, parfois difficilement déchiffrables. Comment avez-vous effectué vos choix ?
F. T. -. Chacune des images est liée, naturellement, au livre de poèmes ; mais je vous l’ai dit, c’est une relation ténue, je n’ose dire secrète ; à chaque Lecteur, s’il le souhaite, de la déceler, de l’interpréter. L’expliciter ici ne servirait à rien, et ne ferait que passer à côté d’une intention qui n’a pas à être davantage déflorée. En revanche, je ne vois guère d’images « difficilement déchiffrables » : plusieurs lectures en sont possibles, mais il y en a toujours au moins une qui s’impose tout de suite, à mon avis.
J. de R. -. Des millions de photographies se font tous les jours, et depuis l’avènement des images numériques l’on peut sans exagérer parler d’une véritable folie de l’image, chacun pouvant être un photographe sans avoir besoin d’acheter nécessairement un matériel coûteux, et sans passer par des laboratoires de développement. Pourquoi en ajouter ? En songeant à La Bruyère, tout n’a-t-il pas été montré déjà ? Ne sommes-nous pas saturés ?
F. T. -. Le photographe souhaite s’approprier l’image comme le peintre aime se confronter à la ligne et à la couleur, comme l’écrivain aime s’approprier le langage commun, tout d’abord ; mon regard n’est pas le vôtre ; et j'aime croire que la phrase « Tout est dit, et l'on vient trop tard depuis plus de sept mille ans qu'il y a des hommes qui pensent », qu'on trouve sous la plume raffinée de Jean de La Bruyère, fut précisément une belle pensée nouvelle ! Ensuite, la photographie ne devient attirante et attachante que lorsque qu’on cesse de l’employer pour simplement montrer les choses. Elle est la recherche de l’ombre, si j’use de ce terme dans le sens double qu’il avait au bas Moyen Âge et jusqu’à Maurice Scève : celui que nous connaissons encore et celui de « reflet ». La photographie, certes, séduit parce qu'elle sait livrer la réalité (presque) telle qu'on la voit, et j’en use également, parfois, ou pour une part, dans ce sens ; mais même dans la prise de vue d’un beau château mille fois photographié, même dans la « carte postale » montrant un parc, un paysage rêveurs, elle peut devenir un moyen d'expression neuf et beau lorsque le simple mode descriptif est écarté, et que la recherche se porte sur l’évocation et la suggestion de ce qui est caché, de ce qui n'était pas vu, de ce qui attendait, et attendait d'être vu, que cela soit de l’ordre du symbolique, de l’intime ou du mystère. Le photographe expérimente cette tension constante surgissant entre la présence des choses à la prise de vue et l’absence des choses une fois que l’image existe ; entre son regard et les choses, entre son monde intérieur et le monde extérieur (ce qu’on appelle le « réel »), entre ce qu’il voit et ce qu’il choisit de montrer, c’est peut-être son ombre propre qu’il cherche à percer, ou bien qu’il approfondit – aussi bien ce serait, même si l’expression peut sembler un peu grandiloquente, l’ombre du monde et des choses.
Frédéric Tison, Les Effigies, un carnet de photographies (2009-2013),
auto-édition Blurb, 2013. 160 pages, 76 photographies (couleur et noir & blanc)
08:35 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens, Sur la photographie | Tags : frédéric tison, photographie, entretiens, jean de rancé | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
jeudi, 10 octobre 2013
Entretiens avec Jean de Rancé — Sur la poésie (suite)
Jean de Rancé. -. Cher Frédéric Tison, je vous propose maintenant d’en venir à vos récents recueils proprement dits, Les Ailes basses tout d’abord, puis Les Effigies…
Frédéric Tison. -. Cher Jean de Rancé, pardonnez-moi de vous interrompre…
J. de R. -. Mais je vous en prie…
F. T. -. … ce ne sont pas des recueils, mais des livres : je n’ai pas rassemblé au petit bonheur la chance des textes épars, mais au contraire je prétends avoir mûri longuement une architecture. Les Ailes basses et Les Effigies s’efforcent donc d’être des livres — réussis ou pas.
J. de R. -. Ces deux livres, donc, me semble-t-il, sont d’abord une réflexion sur la poésie.
F. T. -. Vous me faites un peu peur ; je n’aimerais pas passer pour un formaliste aux livres abscons et soporifiques, où la prétendue réflexion sur le poème prend le pas sur le poème lui-même, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui… Ils ne sont nullement d'abord des réflexions sur la poésie, mais le miroir est à jamais inévitable, en effet, dans le poème.
J. de R. -. Je songeais surtout aux interrogations sur le nom qui parsèment vos livres, et qui ont lieu dans le poème.
F. T. -. Le nom est ce qui s’effondre, ce qui est à rassembler — peut-être est-ce parce que j’ai une excellente mémoire des visages, des paysages et des tableaux tout aussi bien, et que le nom, à l’inverse, m’échappe souvent. La recherche du nom passe peut-être par la recherche du visage, qui me rappelle en écho le nom que je perds… que je croyais perdu. En ce sens ce que j’ose à peine écrire "ma" pratique de la poésie rappellerait l’art de la mémoire, cette pratique mnémotechnique des Anciens fondée sur l’image et qu’explore Frances A. Yates dans son beau livre L’Art de la mémoire.
J. de R. -. Je discernerais volontiers dans Les Ailes basses le nom d’ « Isnel », central, et celui de « Jésus ». Il me semble que ce sont là des figures autour desquelles tout le reste s’articule.
F. T. -. Vous parlez là des noms propres du livre… Mais on pourrait tout aussi bien parler de n’importe quel nom, je veux dire de n’importe quel mot du livre, et voir que chacun d’eux résonne à la manière d’un nom doté d’une majuscule.
J. de R. - Pourriez-vous cependant éclaircir la forte présence de ces deux Noms ? Cela constituerait une bonne introduction, ce me semble.
F. T. -. Peut-être… Le nom de Jésus, on a parfois besoin de le rappeler aujourd’hui, est constitutif de la pensée occidentale — qu’on le veuille ou non.
Quand on manie la langue française, quand on se mêle de créer en son sein, ce que propose l’élaboration d’un poème, il me semble naturel que s’y développe une réflexion — un miroir posé — sur le religieux des choses, et plus particulièrement sur le christianisme, dont est pétrie la langue française tout d’abord, comme en sont pétris notre pays, notre relation au temps, à l’art, à l’amour — à la vie en un mot. Il n’est pas toujours superflu de rappeler (notre époque est si oublieuse, surtout si peu soucieuse du passé qu’il est toujours bon de le faire) qu’une immense part de notre littérature, des tableaux de nos musées, de notre musique, est inintelligible en dehors du christianisme. Même l’athée, le "laïc" le plus intelligent, en Occident, se méprend s’il ignore cela : car il mésestime alors la pierre de l’église romane, celle de la cathédrale, qui se mêlent indissolublement à son architecture intime. Du visage de nos villages à Bernanos et Claudel bien sûr, mais aussi aux écrits de Sade, aux cris d’Artaud et au "sacré sans Dieu" de la musique de Sibelius, le christianisme est une des rivières qui nous parcourent.
J. de R. -. Vous considérez-vous vous-même comme "chrétien" ?
F. T. -. Je n’ai pas eu d’éducation religieuse, et jusqu’à un âge avancé je ne connaissais que des bribes de la Bible. Ce n’est qu’un peu avant mes trente ans que je lus réellement, et entièrement, toute la Bible hébraïque et le Nouveau Testament ; on le voit, je fus longtemps, comme presque tout le monde, le demi-ignare qu’une grande part du système éducatif depuis la dernière guerre contribue à créer au nom de l’égalité des chances, et je fis des lectures à vingt-cinq ans qu’un collégien de 1900 connaissait déjà, alors qu'on prétend aujourd'hui encore éduquer le peuple. Le seul avantage à être un autodidacte, c’est de mesurer les distances, davantage que ne le fait tout homme qui a eu la chance d’être renseigné plus tôt. On s’en aperçoit mieux, quand on a dû faire le parcours tout seul, que lorsqu’une édition des Évangiles traînait familièrement sur la table du salon familial. Je crois que l’histoire religieuse chrétienne devrait faire partie des programmes de l’Éducation nationale française, en dehors de tout aspect confessionnel : je le répète, comment comprendre la littérature, les tableaux des églises et des musées, l’histoire de notre pays, sans un minimum de connaissances bibliques ?
La question de la croyance religieuse n’est pas aussi cruciale à mes yeux qu’elle pourrait l’être — et peut-être devrait-elle l’être… Je ne sais pas si je crois en Dieu ou non. Je suis incapable de répondre, ou bien mes réponses seront-elles celles de mon époque, inversées ou conformes. Je le suis tout autant quant à la question de l’existence ou de la non-existence de Dieu — une question qui est d’ailleurs sans doute très mal posée, avec de mauvais termes, veux-je dire. Dire que "je" "crois", c’est déjà mettre à distance sa propre croyance, c’est déjà en douter : les Pères de l’Église le savaient déjà… Je ne me sens pas "chrétien" au sens strict de "pratiquant", certes, dans la mesure où la croyance aux dogmes chrétiens me trouve largement "sceptique", mais je ne me sens pas non plus "athée", encore moins "agnostique", ce terme qui sert trop souvent de prétexte à quelque flou de l’esprit, et qui est employé à tort et à travers par des personnes qui souvent se moquent de tout ce qui touche à "Dieu", et qui se moquent a priori de toute question spirituelle, s’abritant souvent derrière la notion d’un "sacré sans Dieu" qui reste aussi vague que la "poésie d’un paysage" dont nous parlions naguère. Mais lorsque j’entends le mot "chrétien", je me sens plus proche de lui que de celui de "bouddhiste" ou de "musulman", épithètes et confessions qui me sont totalement étrangères – je n’ai de curiosité ni d’intérêt pour elles que depuis un absolu Dehors. Mon "intérieur", dès lors, est également "chrétien", et même "catholique", puisque je suis français ; c'est ainsi. Et je suis un homme fidèle avant tout, et d’une fidélité qui n’est pas soumission... La tabula rasa ne m’est étrangère que parce que je la sais impossible : je suis, ma pensée, mon histoire, mes "conceptions", mon langage, sont façonnés par la civilisation dans laquelle je suis né, et qui est chrétienne pour une très large part. Souvenez-vous des Surréalistes, et du fameux numéro 3 de La Révolution surréaliste proclamant l’année 1925 comme « fin de l’ère chrétienne » ; c’était le terrible et magnifique Antonin Artaud qui était à l’origine de ce projet. Mais n’était-ce pas là toujours se poser en fonction du christianisme, selon un regard ? On n’y échappe pas, sauf à décréter qu’il n’est pas constitutif de notre identité, ce qui est faux. Nos notions du temps, de l’esprit, de la matière, de l’origine, de l’amour, de la vie en sont issues —ce n’est pas rien…
Je rapproche Dieu de l’inquiétude — de ce qui demeure ouvert. Un poème est toujours peu ou prou une prière, célébration ou douleur, une question. La théologie négative chrétienne, dite l'apophatisme, est très féconde en ce qu’elle indique, en tâtonnant, les chemins à suivre, elle explore ainsi que le poème, elle est une pensée qui se déploie comme la musique.
J. de R. -. Y a-t-il au sein de la doctrine de l’Église catholique quelque chose dont vous seriez proche ?
F. T. -. Ses dogmes ont tant varié. Le christianisme d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celui de saint Augustin, ni avec celui du Concile de Trente. On demande depuis le XIXe siècle à l’Église de se moderniser, mais c’est stupide, l’Église, même du temps de sa splendeur, même quand elle irriguait la pensée dominante, s’étant toujours adaptée à son époque. Et puis, l’Église a eu tort de renoncer, récemment, à l’existence des Limbes, puisque j’y suis…
J. de R. -. Venons-en maintenant à l’autre figure "tutélaire". Isnel est une figure centrale de votre livre ; on dirait que tout le livre l’appelle, tourne autour de lui, mais on a du mal, à mon sens, à saisir véritablement son essence. Il n’est pas d’abord un nom propre, mais un adjectif ancien, qui signifie « rapide, léger », que vous attribuez à un personnage autour duquel vous semblez tâtonner.
F. T. -. C’est qu’Isnel est lointain, insaisissable… Oui, il est rapide et léger, et son nom même est un souvenir, en ancien, en moyen français : ysneal, isnial, isnel, adjectifs signifiant « prompt », « agile », « léger », « habile », « vif », « preste », « aérien », mais aussi « élégant »... Outre que le mot est à lui seul beau comme un poème entier, il agit sur moi comme un visage… J’ai rêvé d’une muse qui fût un garçon. Au fond, je ne puis rien dire d’autre que cela, en dehors de ce que le livre dit de lui, même si c’est un personnage qui reviendra dans mes prochains livres.
J. de R. -. Si j’ai été séduit par Les Ailes basses, j’aimerais cependant nuancer. Nous sommes convenus que ces entretiens ne seraient pas une succession d’éloges à votre gloire…
F. T.- … Bien entendu, quelle sottise !...
J. de R. - … et c’est ainsi que j’ai souhaité aborder avec vous ce que je nommerais mes réserves. Vos poèmes "tranchent" avec la production poétique contemporaine, où je discernerais volontiers, et très grossièrement, deux tendances : l’une est celle de l’effacement, du refus de l’image, et elle assèche le vers afin de l’éloigner d’un "lyrisme" jugé caduc ; l’autre, héritière du surréalisme, est celle de la surabondance au contraire de ces images, toujours plus audacieuses, et elle disloque le vers jusqu’à le rendre méconnaissable. Et il me semble que vous n’appartenez ni à l’une ni à l’autre de ces tendances : le lyrisme caractérise nombre de vos écrits, selon moi, et certains de vos vers, certaines de vos images n'échappent pas à la facilité, toujours selon moi, et surtout semblent négliger l’apport des écritures poétiques nouvelles, celles d’un Michaux, d’un Roubaud, d’un Deguy, ou d'un Bonnefoy.
F. T. -. Paul Farellier m’a dit un jour, en évoquant la réception de mes poèmes : « Vous aurez du mal ». Il voulait dire que mon écriture s’éloignait de ce que le lecteur de poésie, aujourd’hui, est habitué à rencontrer. Je n’ai jamais cherché l’originalité pour elle-même, mais "simplement", si j’ose dire, l’expression d’un chant qui est en moi, que je sens depuis fort longtemps, et qui m’échappe souvent, et que je cherche à retenir : le poème retient, oui, quelque chose d’une lame de fond sonore en moi, une cadence, comme un souvenir sans cesse recommencé. Aussi bien mes livres, en ce sens, seraient-ils l’expression de la recherche de ma propre voix, de celle qui est en moi, que j’entends… Comment, alors, ne seraient-ils pas différents ?
Quant à négliger les apports des écritures nouvelles… Vous savez, je n'ai pas eu de maître, je ne m’en suis pas reconnu, ou plutôt j’ai des admirations étrangères les unes aux autres ; j’ai écrit ailleurs que « tous les maîtres s'annulent » : et, en effet, quoi de plus ennemies que les esthétiques de Ronsard et de Rimbaud, que celles de Paul Valéry et de Pierre Jean Jouve ? Et cependant, pourquoi en élire l’une contre l’autre ? Pourquoi ne pas les élire toutes, je veux dire toutes celles que l’on aime ? Quand j’écoute Bach, je peux aimer encore Sibelius. Et quand j’écoute Tchaïkovski, je ne déteste pas Purcell. De la même manière que notre cœur, quand nous aimons, n’est pas asséché par l’amour d’un seul être, des auteurs très différents, et je l’ai dit, ennemis, peuvent trouver en nous une admiration, une passion égales – même si stratifiées, selon l’heure...
Il ne s’agit évidemment pas de créer une œuvre composite, de bric et de broc, mais de cerner ce qui est en soi, et que, parfois, certaines influences littéraires ont rapporté à la surface.
Cela dit, je ne réponds pas là à votre question : facilité, que certaines de mes images ? Je n'ai pas peur du cliché : si ces yeux sont des étoiles, si je l'écris, que m'importe ? Si j'ai aimé cela, si je l'ai vécu, si je l'ai vu, si je l'ai touché. Une réminiscence livresque peut très bien rencontrer une source réelle en nous. La tentation de la nouveauté à tout prix est sotte à mes yeux ; la valeur en soi de la nouveauté est absolument nulle : elle érige en nouveauté ce qui est norme justement : la norme conformiste du "nouveau". Ceci est évidemment valable pour notre temps : Baudelaire demandant au Ciel ou à l’Enfer du « nouveau », et peignant « la vie moderne », même pour s’en affliger, parfois, Verlaine évoquant le « zinc » des toits, Rimbaud parlant des « villes splendides » et déclarant qu’il faut être « absolument moderne », parlent dans un univers mental différent du nôtre, qui a vu depuis ce qu’il fallait attendre de la modernité : la violence décuplée, la laideur, la vitesse décervelée, le dernier gadget technique et la dernière information à la mode venant combler un ennui et une effarante indifférence devant tout ce que le passé nous a laissé en héritage, devant la voix des morts, leurs châteaux et leurs paysages. Le « contre Chopin » de Michaux (dans Passages) est navrant à mes yeux ; mais cela se voulait « révolutionnaire », et l'on sait désormais ce que cela veut dire.
Un malentendu concernant le « langage gris » que voulut Paul Celan me semble également à l’origine d’une certaine poésie d’aujourd’hui, et de sa réception. Lui répondait à sa manière à la fameuse phrase et la plus idiote écrite par Theodor Adorno (que celui-ci a fini d’ailleurs par nuancer, de façon inutilement compliquée) selon laquelle la poésie était impossible après Auschwitz. Comme si la poésie n’était pas aussi, avec l’éloge, la célébration, l’amour et le don, la manifestation d’une horreur ! Comme si elle n’avait pas toujours été un Chant affrontant le glacé, l’innommable, la violence, la bêtise, la haine et la perte, comme si elle n’avait jamais embrassé toute la vie, le jour et la nuit… La poésie est au contraire, depuis Auschwitz, indispensable, et toujours possible, terriblement, et heureusement… La poésie est le Possible, justement. La poésie est inépuisable, comme Ovide, dans ses merveilleuses Métamorphoses, le savait.
Cela dit, vous dites avoir distingué deux tendances, mais il me semble que vous faites l’impasse sur nombre de poètes qui, aujourd’hui, tentent de se frayer un chemin entre celles-ci, et ne négligent pas du tout rythme ni chant. Je pense notamment à Lorand Gaspar, à Lionel Ray, à Yannick Girouard, à Pierrick de Chermont, à d’autres encore.
J. de R. -. Il me faudra les lire. Les Ailes basses est également le livre d’un lecteur, me semble-t-il. Déjà les proses contenues dans Les Contemporains intérieurs étaient des sortes d’hommages d’un lecteur, des échos. Je pense aux épigraphes et aux nombreuses références clairsemées, je cite pêle-mêle les Évangiles, Hérodote, Du Bellay… sans parler des résonances internes.
F. T. -. C’est juste : tout ce que j’écris est lié au temps et à la mémoire — en cela, oui, écrire est aussi le fait d’un lecteur. Vous parlez de résonances, c’est tout à fait cela : mes Histoires amnésiques s’interrogeaient sur la mémoire, sur sa place dans la composition de poèmes ou de contes : elles la reconnaissaient comme centrale, native, malgré la tentation du nouveau.
J. de. R. -. Parmi les épigraphes figurant à l’ouverture de chacune des cinq parties de votre livre, je relève celle d'un poème de Pierre Jean Jouve. Quel rapport entretenez-vous avec l’œuvre de cet écrivain ?
F. T. -. Je tiens Pierre Jean Jouve pour le plus grand des poètes français du XXe siècle, le plus grand que je connaisse ; il n’a pas été dépassé par ses successeurs ou disciples, et aujourd’hui encore il n’en est pas de vivants (connus !) qui l’égalent. Il est pour moi une sorte de modèle, non pas un maître ! et à l’instar de celles de Baudelaire, de Verlaine et de Mallarmé j’aime inconditionnellement sa poésie. C’est qu’il a su renouveler la langue poétique tout en l’inscrivant dans une tradition qui remonte aux trouvères et aux troubadours — je veux parler notamment du trobar, et plus précisément du trobar clus, que l’on réduit trop souvent à un hermétisme pour savants mais qui est surtout l’expression d’une difficulté spirituelle devant la langue, une interrogation, un forage. Pierre Jean Jouve réunit la poésie, en lui résonnent aussi bien Raimbaut d’Orange que les grands modernes. Il semble moins audacieux qu’un poète surréaliste ou qu’un Michaux, moins "provoquant" ou "novateur" qu’un Jacques Roubaud ou un Michel Deguy, mais sa révolution est beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde aussi, que celles de la plupart des expérimentations des autres « chercheurs solitaires » du XXe siècle. Car c’est un Chant qui s’élève, un Chant magnifique, inépuisable, aussi beau que le ciel parcouru de nuages, aussi profond que la terre et ses plaines, et ses montagnes, aussi troublant qu’un corps aimé, aussi atroce (au sens ancien de « noir ») que la peur. Matière céleste bien sûr, mais aussi Diadème et Mélodrame sont des absolus de beauté — je n’ai pas peur d’user de termes aussi forts…
J. de R. -. Je note également un poème en forme d’hommage à Jean Sibelius. Pourquoi lui, en particulier, car si j’en juge par vos goûts musicaux, comme je puis le constater dans votre "discothèque", ici, dans votre appartement, vous aimez autant la musique médiévale que Purcell, Bach, ou Debussy ?
F. T. -. Vous oubliez Couperin, Rameau, Haydn, Haendel, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Wagner, Tchaïkovski, Richard Strauss, Bruckner, Janacek, Prokofiev, Rachmaninov, Ravel…
J. de R. -. En somme, vous aimez toute la musique…
F. T. -. Oh certes, presque toute la musique, en effet, même si vous noterez mon peu de goût pour la musique italienne, notamment ses opéras : ce n’est pas que je ne l’apprécie pas quand je l’écoute, mais je ne m’y penche jamais, j’ai toujours une autre musique à écouter avant elle ; et j’ai naturellement des affinités électives, parmi lesquelles Jean Sibelius. J’ai un profond amour pour la musique de Jean Sibelius. La première fois que je l’entendis, elle me sauta littéralement aux oreilles, si vous me passez une expression que je jugerai bientôt malheureuse, sans aucun doute ! : c’était, je m’en souviens, à la radio, à bord d’une voiture, lors d’un voyage en Italie, en Ombrie, en 2008 ; c’était très curieux, cette musique sombre, nordique, hautaine, lointaine, au sein de ces paysages jaunes et bleus écrasés de soleil. Je la fis mienne sur le champ ; j’avais cette bienheureuse sensation, inoubliable, enivrante de hauteur et de belle vanité, que j’aurais pu être le compositeur de cette musique : c’était la Sixième Symphonie, je crois : sublime, souveraine, inépuisable et incomparable, pour user d’un adjectif qui désormais me semble avoir été créé par Pierre Jean Jouve pour son Hélène (« C’est ici que vécut incomparable Hélène »…). À mon retour à Paris j’acquis sans tarder l’Intégrale des symphonies, puis, peu à peu, tout le reste de l’œuvre enregistrée... Non seulement j’aime inconditionnellement cette musique, mais j’aime aussi, même si c’est en marge de mon amour, qu’elle soit une "provocation" : tout en étant moderne, Sibelius résiste aux expérimentations musicales ; songez qu’il lance au monde sa Septième Symphonie, lyrique, dramatique, passionnée, d’une écriture fondamentalement tonale, au moment où triomphent le dodécaphonisme et la musique sérielle, auxquels je demeurerai, je pense, toujours étranger ; je veux bien les comprendre, mais comme je m’ennuie en écoutant Boulez ou Stockhausen ! Les amateurs éclairés n’y verront, peut-être à juste titre, que l’aveu d’une insuffisance. Tant pis pour moi ; mais comprendre n’est pas aimer… Quel ennui de seulement comprendre, et d’en avoir l’impression, même illusoire… « Comprendre, c’est tout mépriser », n’est-ce pas… Je préfère aimer. Or cette musique est trop souvent une musique qui doit être comprise.
J. de R. -. Selon vous, si elle est celle d'un lecteur, la poésie est donc une célébration, un éloge, un hommage ?
F. T. -. Elle n’est pas cela ; elle ne saurait s’y réduire, mais elle contient l’éloge, la célébration, l’hommage, oui ; elle ne commente rien, mais elle participe, elle accompagne, elle aime.
J. de R. -. Nous ne parviendrons pas encore, dans cet entretien, à véritablement proposer une définition de la poésie.
F. T. -. Non. Comme je l’ai dit, nous tâtonnons.
Avez-vous remarqué que les "définitions" et "preuves d’existence" que l’on prête ou attribue à Dieu pourraient fort bien s’appliquer à la poésie (vous noterez que je n’ai pas dit au poème) ? La poésie est une sphère dont la circonférence est partout et le centre nulle part… La poésie est ce qu’il y a de plus haut dans la pensée… La poésie est Amour… La poésie est Vie… La poésie est Chemin... Réunissez-vous en son Nom et elle est au milieu de vous… Et même : Elle viendra comme un voleur… Mais, contrairement à ce que disent de Dieu ceux qui prétendent le connaître, je ne parle de poésie qu’avec humilité, ma voix étant l’ombre — et l'effigie — d’une plus grande voix : un poème est une avant-dernière voix, avant la poésie. Si je savais ce qu’est la poésie, je ne tenterais pas d’écrire des poèmes. Il n’y a que peu de choses, quand on y songe, qui méritent la majuscule qu’on octroie à Dieu : l’Amour, la Poésie… Quant au reste…
J. de R. -. Avec l’esprit de l’escalier : Pourquoi conserver la majuscule en début de vos vers ? N’est-ce pas un archaïsme ?
F. T. -. Sans doute, et je connais bien sûr les poèmes des poètes qui se sont débarrassés de cette majuscule inaugurale pour chaque vers, à l’imitation (car je crois que c’est lui qui le premier créa cet effet) du merveilleux poème « Mémoire » de Rimbaud, dont les seules majuscules sont destinées au premier mot d’une phrase, et non plus du vers. J’ai dit que c’était un effet, c’est bien sûr davantage que cela, notamment un recommencement subtil en début de vers, et non plus une triomphale ou fatale inauguration, mais c’est un effet malgré tout : cela n’ajoute que peu de choses à la fin, et en tous cas rien au rythme ni au chant, et cela présente également le désavantage d’être peu lisible dans un livre imprimé, de ne pas assez signaler le vers, visuellement, pour peu que le vers soit long, et se métamorphose sur la page en un peu clair "entre-deux" de prose et de poésie, ou bien en versets. Commencer le vers par une majuscule est une convention que j’aime, que je m’approprie en la respectant, et que je comprends "esthétiquement" ; c’est encore et toujours un effet, certes, mais sanctionné par une belle et rêveuse tradition, et pleinement justifié par sa beauté bizarre…
(à suivre.)
10:49 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens | Tags : frédéric tison, jean de rancé, entretien, poésie, poème | Lien permanent | Commentaires (2) | ![]() Facebook |
Facebook |
mercredi, 02 octobre 2013
Entretiens avec Jean de Rancé — Sur la poésie (suite)
Jean de Rancé. -. Frédéric Tison, vous publiez ces jours-ci Les Effigies, aux Éditions Librairie Galerie-Racine.
Frédéric Tison. -. Oui, et j’en profite pour signaler à nos internautes qu’une séance de dédicaces aura lieu, au 23, rue Racine à Paris (métro Odéon), de cinq heures et demie à huit heures du soir, le mardi 8 octobre 2013.
J. de R. -. Nous avions annoncé, dans la première partie de nos entretiens sur la poésie, la parution prochaine de cette deuxième partie, et nous voilà en retard de très nombreux mois…
F. T. -. Voyons, cher Jean de Rancé, par rapport à quoi serions-nous en retard ? Nous n’avons pas à décréter pour nous-mêmes qu’un "prochainement" doive s’accomplir dans la précipitation et la vitesse, comme toute la prétendue "actualité" frénétique de l’information officielle le proclame et l’impose partout… Soyons donc inactuels, en déclinant le mot : être parfaitement inactuels pour trouver et retrouver le réel – c’est-à-dire le Passé – c’est-à-dire le Présent – et ainsi tenter d’être véritablement actuels dans le Temps… de véritables contemporains, en somme.
J. de R. -. C’est que Les Ailes basses ont bientôt trois ans…
F. T. -. Mon Dieu ! C’est une éternité voulez-vous dire, quand l’"actualité" contemporaine oublie ce qu’il s’est passé une semaine auparavant… Permettez-moi de vous dire que ce point de vue me semble bien aveugle.
J. de R. -. Oui, je me laisse sans doute influencer par la pensée oublieuse de nos "décrypteurs de l’actualité "...
F. T. -. C’est vous qui le dites, cher ami.
J. de R. -. Il me semble que nous sommes restés naguère à des généralités. Ainsi, peut-être, avant de poursuivre, serait-il utile, notamment à propos de vos Ailes basses, ce livre ayant été à l’origine de notre rencontre, que vous nous parliez un peu de vous ?
F. T. -. … Je ne crois nullement à l’intérêt que revêtent les propos d’un auteur sur lui-même : tout ce que je pourrais vous en dire ne serait que l’écume, ou la surface, un miroir inévitablement déformé, sans même qu’intervienne la volonté de tromper. Cela dit, et cela peut paraître contradictoire, je pense que dans tout auteur sommeille un "autobiographe" : il clairsème ses épisodes plus ou moins secrètement dans ses écrits. Je ne m’étendrai donc pas sur les événements personnels de ma vie, mais sur les circonstances qui ont présidé à la publication du livre Les Ailes basses, en décembre 2010. Car s’il m’est arrivé mille et une choses, ce que j’ai vraiment à en dire se trouve dans mes petits livres, et nulle part ailleurs. Je comprendrai alors votre question selon cet angle : celui de savoir d’où parle l’auteur. Quant à la genèse de cette publication, qui sait si quelques éléments ne seront pas utiles à quelque auteur ?
Tout d’abord, je dois préciser que je ne fais partie d’aucun cénacle, et que j’ai toujours été profondément seul face au "monde de l’édition". Mes proches, qui m’ont cependant toujours encouragé, ou du moins ne m’ont pas découragé, ne font ni de près ni de loin partie de ce petit monde, et personne ne m’a jamais "poussé" vers lui. D’autre part, je n’ai pas connu avant longtemps de personnages influents. J’ai grandi dans le monde réel, c’est-à-dire celui où quelqu’un qui souhaite écrire se construit seul, contre, et malgré tout. Car le monde contemporain, voyez-vous, est fait de telle sorte qu’on ne puisse pas écrire un poème.
J. de R. -. Qu’entendez-vous par là ?
F. T. -. J’ai écrit un jour un petit "aphorisme", si vous me permettez de le nommer ainsi, et si vous m’autorisez à le citer, selon lequel « La vie moderne est d’interrompre sans cesse la lecture – des livres, des choses et des êtres aimés » (c'est une "minuscule" du Clair du temps I). Tout est là, je crois : ce n’est pas tant de précipitation que nous sommes victimes que de morcèlement, lequel, certes, est l’une des conséquences de cette vitesse excessive des choses, mais de cette dernière il reste encore possible de se mettre à l’abri, en éteignant la radio et en renonçant à certains rendez-vous, par exemple. Ce morcèlement mortifère, ennemi de toute méditation, interdit la lecture vraiment suivie d’un livre, l’écoute complète d’une symphonie, ne parlons même pas d’un opéra, en un seul jour, si nous ne luttons pas de toutes nos pauvres forces contre lui. Borges disait que l’invention du miroir avait été pour l’homme une abomination ; j’ajouterai que non moins abominable fut l’invention, au XIVe siècle, de l’horloge telle que nous la connaissons, de la montre, de ces objets qui, non contents de nous rappeler, comme dans le poème de Baudelaire, notre mort prochaine à chaque instant, segmentent nos vies et n’en font que la succession de moments décousus, inaptes à l’écoute de la beauté ; l’horloge parlante, cette voix d’outre-tombe, les horloges urbaines, nos téléphones portables (qui se substituent désormais aux montres), sont d’impitoyables dictateurs, tueurs de la paresse, du temps vide, de la vacance, ce sont les assassins des temps morts, comme le jargon du sport le dit bellement. La composition d’écrits, puis celle d’un livre, souffrent également de ce morcèlement. Pour ne prendre qu’un exemple, je crois que l’aspect fragmentaire de l’œuvre de Mallarmé, au lieu d’avoir pour seule origine une esthétique du fragment, ce que sait certes être, naturellement, la poésie, cet aspect fragmentaire, disais-je, est dû aux conditions de son existence, lesquelles annonçaient les nôtres.
J. de R. – Notre époque est-elle si particulièrement mortifère ?
F. T. -. Pour ses raisons propres, oui, assurément. Mais il faut regarder autour de soi : voyez ces contempteurs qui passent leur temps à se lamenter, sans rien créer, sans rien partager surtout ; on a envie de leur dire : « Mais enfin, créez ! C'est à votre tour ! », « Regardez autour de vous ! » J’ai déjà parlé de cet archipel de solitudes qui nous fait défaut. Combien pleurent un Jadis idéalisé où la poésie avait droit de cité, était lue, commentée, aimée, alors qu’ils ne s’intéressent même pas à ceux qu’il serait si facile de rencontrer aujourd’hui, dont les livres ou les œuvres sont disponibles ? D’autre part, la beauté n’est certes plus adoubée par le pouvoir, et alors ? C’est ainsi. Il y a beaucoup trop d’artistes et d’esthètes qui meurent de la mort de l’art, une mort qui eût été repoussée encore, avec la pierre qu’ils eussent pu apporter à l’édifice, s’ils avaient su, cette pierre, la polir et l’élever. Philippe Muray avait certes un regard souvent pertinent sur notre temps. Mais lorsqu’il prétend constater la fin de la poésie, comme Richard Millet d’ailleurs, il dévoile surtout, en ce domaine, son manque de curiosité.
J. de R. -. Pourquoi avoir choisi la poésie comme mode d’expression ?
F. T. -. Je ne saurais le dire. La poésie fut tout d’abord ce que j’ai aimé, ce que j’ai commencé d’aimer sans rien y comprendre, ou presque… Je n’ai rien « choisi », ou plutôt j’ai élu ce que j’aimais.
J. de R. -. Pourriez-vous dès lors retracer l’histoire de l’écriture et de la publication de vos livres ?
F. T. -. Écrire est une aventure toute personnelle ; on écrit pour s’éclairer de l’intérieur, si j’ose dire. J’ai d’abord été un lecteur admiratif. Ce sont les contes et les récits d’aventure qui m’ont d’abord retenu, comme tous les enfants. Je me souviens que je dévorais, enfant, les contes de fées, et les romans d’Alexandre Dumas (les Trois Mousquetaires furent mon premier livre de chevet), puis, adolescent, les romans policiers d’Agatha Christie et ceux de Patricia Highsmith, au point qu’à douze ans, j’écrivis un petit "roman policier", que j’ai toujours dans mes papiers et qui est amusant, avec tous ses défauts. Un peu plus tard je lus des livres de poèmes, et je me rappelle mon professeur de français, en troisième, qui nous fit étudier « L’Horloge » de Baudelaire en nous disant que le livre entier n’était pas, selon elle, destiné à des adolescents ; bien entendu, je me précipitai sur Les Fleurs du mal dans la bibliothèque de mon collège. Je n’y compris, évidemment, pas grand-chose tout de suite, mais il est certain que quelque chose "s’ouvrit" alors. Ces mots, ces vers étaient comme un paysage que je voyais pour la première fois, et quelqu’un, véritablement quelqu’un parlait, douloureusement, passionnément, ironiquement aussi. Je trouvais cela magnifique, même si je me doutais bien que je n’y avais pas totalement accès. J’éprouve d’ailleurs cette impression devant une œuvre que je découvre, encore aujourd’hui.
Si j’écris "sérieusement" depuis l’âge de dix-huit ans, passé l’âge des (mauvaises !) imitations lamartiniennes et baudelairiennes, je n’ai publié qu’à l’âge de trente-trois ans, en 2005, un premier livre, et j’ai publié Les Ailes basses, le deuxième, à l’âge de trente-huit ans. Il ne s’agit pas du tout d’un choix délibéré, car j’ai essayé sans succès de publier, dès mes vingt-deux ans, mes livres de poèmes, en les envoyant à des éditeurs et en participant même à des concours de poésie. Tout cela fut vain, je me heurtais durant de nombreuses années à une parfaite indifférence, qui allait de la banale réponse laconique (comme la fameuse « Votre livre n’entre pas dans l’esprit de notre maison » et autres implicites « Allez voir ailleurs si j’y suis »…) au non moins commun silence le plus méprisant. Tous les auteurs sans relations connaissent cela – avec le recul, je puis dire que c’est très instructif. Quant aux concours, je cessai rapidement d’y participer en découvrant les livres des lauréats, qui me semblèrent, le plus souvent, d’une telle médiocrité que je compris vite que j’avais affaire, la plupart du temps, non pas à des "découvreurs" sincères mais à des systèmes de cooptation où les manuscrits envoyés n’étaient pas vraiment lus, où les personnes comptaient davantage que l’écrit – ce qui est aussi le cas dans l’édition, naturellement, quoique dans une part moindre. Non que je crusse à l’excellence de mes écrits, prenant la pose du poète maudit dont les écrits auraient été injustement rejetés : mais me mit la puce à l’oreille le fait que jamais un dialogue ne se nouait ; j’envoyai tout de même des livres, des poèmes, c’est-à-dire, oui, un peu de mon cœur, comme le mouchoir imprégné de trois gouttes de sang que la Reine confie à sa fille qui s’en va épouser un Prince lointain, dans La Gardeuse d’oies des frères Grimm : cela m’a toujours semblé mériter une réponse digne de ce nom, même négative – peu importe. Que l’on soit éditeur et que l’on puisse ignorer ce que coûte, ni surtout ce que signifie l’écriture d’un livre au point de ne même pas répondre personnellement à son auteur me semble inconséquent. Et ce, même si l’on reçoit des centaines de manuscrits. De 1997, après avoir achevé mes études, quand je commençai d’exercer mon métier de bibliothécaire scolaire (dénommé "professeur documentaliste"), à 2002, je renonçai à toute démarche éditoriale. En 2003 je me lançai de nouveau, avec mes Histoires amnésiques, qui dataient d’une dizaine d’années, avec un livre de poèmes encore, pour essuyer de nouvelles déconvenues… Cette fois j’étais en contact avec des personnes influentes, mais qui s’intéressaient davantage aux attraits physiques d’un auteur qu’à ses œuvres… Le malentendu ne pouvait qu’être total, et j’ai même goûté, à cette occasion, pour la première fois, à l’expérience, fort instructive, de la calomnie ; et j’ai vu de près la réelle méchanceté, la pure malveillance de certains artistes et écrivains qui, par ailleurs, prennent la pose de l’affabilité et prétendent, de surcroît, donner des leçons de courtoisie !
Parallèlement, depuis 1995, je confectionnais de petits livres artisanaux, à deux, trois, quatre exemplaires, que je destinais à mes proches et à quelques amis, j’y reviendrai. À la fin de l’année 2004, ma mère fit lire mon dernier manuscrit à l’une de ses collègues, qui se révéla l’épouse d’un petit éditeur et qui le lui fit lire à son tour, et cet éditeur se déclara séduit : il publia mon livre, Anuho (Les Quatre Livres), en décembre 2005, à deux cents cinquante exemplaires ; j’étais bien entendu ravi, mais ce fut un échec, il n’y eut aucune véritable distribution. Je ne sais même pas aujourd’hui où sont les exemplaires qui n’ont certainement pas tous été vendus… Je n’en fus cependant pas trop affligé ; cet échec m’avait malgré tout redonné l’envie de publier, car j’en avais effleuré la possible joie, et la seule raison d’être : celle de partager et, peut-être, de trouver des complices. Il va sans dire en effet qu’ayant tiré un trait sur toute possibilité de "carrière dans les lettres", et n’ayant d'ailleurs jamais prétendu en tirer un quelconque bénéfice pécuniaire, je redécouvris ce que je n’aurais jamais dû perdre de vue : proposer ce qu’on a écrit pour rien, dans la simplicité de ce geste pour lui-même, à qui le veut…
Je connaissais un certain nombre de revues de poésie que j’estimais exigeantes. J’envoyai ça et là une suite de poèmes. Quelques revues m’envoyèrent une courte lettre de refus stéréotypée, avec une signature manuscrite photocopiée – d’autres ne me répondirent même pas ; j’avais désormais l’habitude. Mais quelque temps après, je reçus une lettre, une vraie réponse devrais-je dire, pour une fois, d’une bienveillance, d’une intelligence, d’une curiosité telles que je n’en crus pas mes yeux : elle émanait des Hommes sans Épaules, la revue éditée par les Éditions Librairie-Galerie Racine dirigées par le poète et éditeur Alain Breton, et était signée par Paul Farellier, un poète dont j’avais découvert et aimé les poèmes publiés par cette même revue. Cette fois, oui, il y avait quelqu’un. Quelqu’un qui n’était pas de mes amis alors, quelqu’un qui ne me connaissait pas, qui n’avait fait "que" lire, mais lire vraiment (c’est-à-dire qui avait fait son travail) mes textes éperdument envoyés. Quelqu’un qui ne se souciait pas de savoir de qui j’étais le descendant, le cousin ou la connaissance, ni si j’étais jeune, vieux, beau, laid, rouge ou bleu, gentil ou méchant. Quelqu’un, donc, qui avait lu. Quelqu’un dont je devais ensuite, l’ayant rencontré, reconnaître, outre l’amour fervent de la poésie, l’élégance, la droiture et le désintéressement. Que je doive tout, ou presque, à Paul Farellier dans mon accession à une vraie publication, est une vérité dont je suis d’autant plus fier qu’elle est le fait d’un homme admirable…
Ma suite de poèmes (« Adonis ou La Bibliothèque recommencée ») parut dans un numéro de la revue, en juillet 2007. Encouragé toujours par Paul Farellier, qui m’enjoignait de proposer aux Éditions Librairie-Galerie Racine un livre entier, je soumis au comité de lecture, par la Poste encore, Les Ailes basses, un livre achevé au début de l’année 2009, qui fut accepté immédiatement après lecture par Alain Breton, et qui fut publié en décembre 2010. Le livre Les Effigies s’inscrit dans cette continuité.
Assez parlé de mon expérience, que je n’ai évoquée que par égard pour ceux qui comme moi n’ont pas connu la chance d’être "du milieu", une chance relative... Je leur suis fraternel – et je suis la preuve vivante qu’il reste tout de même possible d’accéder, solitaire, inconnu, "anonyme" (comme disent certains journalistes en parlant des personnes qu’ils interrogent et ne sont pas connues, alors qu’elles possèdent un nom, comme les gens célèbres, mais oui), à la publication ; il est deux choses à prendre en compte, outre la patience et le silence des anges : la préalable publication dans une revue, puis le soutien d’un auteur qui vous distingue auprès d’un éditeur en lui montrant du doigt votre livre. Les autres auteurs – la majorité des auteurs publiés en fait – ne comprendront jamais, jamais cela. Je tire de cette connaissance non pas quelque sotte vanité, mais une belle fierté que d’aucuns auront beau jeu de me reprocher, sans rien savoir.
J. de R. -. En consultant votre bibliographie, sur votre blogue, j’ai pu constater que Anuho, votre premier livre édité par un éditeur (à compte d'éditeur, je veux dire), Les Ailes basses et Les Effigies sont la suite d’une longue série de livres auto-publiés. Vous les avez édités vous-même en 2008, puis 2009, alors que le premier date de 1992-1994, et le dernier de 2003 (Je mets à part les éditions, par vos soins, de « textes rares et commentés » dont nous pourrons reparler). Pourquoi des auto-publications si tardives ?
F. T. -. « Longue série », n’exagérons rien… S’il s’agit en effet d’une dizaine de livres, ce sont des livres courts, d’une quarantaine de pages en moyenne ; j’aime beaucoup les plaquettes, et en effet ces livres ou petits livres sont des petits mondes à eux seuls.
J. de R. -. Quelle différence faites-vous entre « livres » et « petits livres », comme vous dites ?
F. T. -. Mes « petits livres » sont non seulement petits par leur taille, par leur longueur, par leur brièveté, mais ils ne consistent pas en un monde "clos" ; ce ne sont pas des jardins, au sens biblique ou médiéval, clos de murs, solitaires, au haut du donjon d’un château ou telles des oasis dans les déserts, mais des fragments de jardins ; mes « livres », eux, sont ces jardins, dont la clôture n’est pas étroitesse, mais ouverture circonscrite sur le ciel.
Des publications tardives, disiez-vous. Eh bien, ces livres existaient, et j’ai eu la prétention de leur ouvrir les ailes autrement. En découvrant les possibilités nouvelles offertes par l’Internet, à savoir des imprimeurs en ligne, tel que Lulu, j’eus l’idée – ou plutôt me l’insuffla mon grand ami Norbert Crochet qui me précéda dans ces démarches, en éditant et publiant ses propres romans et nouvelles ainsi que des éditions de textes méconnus du XVIIIe siècle français – d’éditer mes textes qui dormaient dans des tiroirs, comme on dit, depuis des années… Je le faisais déjà, mais artisanalement, comme je le disais, depuis des années, en des assemblages de feuilles un peu trop volantes imprimées chez moi, en trois ou quatre exemplaires que j’offrais… Lulu offre des possibilités bien plus intéressantes.
Ce ne fut pas du tout exclusivement la démarche d’un auteur refusé par les éditeurs : bien entendu, j’eusse préféré que ces textes connussent une autre édition ; mais je ne confiais pas seulement à l’imprimeur que je payais des textes refusés. Quelle liberté, voyez-vous, que de s’auto-éditer ! La qualité formelle des livres ainsi fabriqués n’a, d’ailleurs, rien à envier à celle des éditeurs consacrés ; le seul problème, évidemment, demeure celui de la diffusion... Mais avoir auto-publié ces livres m’a permis de passer à autre chose, de revenir à des considérations plus importantes également, et d’exploiter cet outil fort divers qu’est l’Internet ; c’était d’ailleurs le temps où je commençais de considérer l’expérience d’un blogue tout à fait "sérieusement", c’est-à-dire de le compter au nombre de mes "publications". Ce n’est évidemment qu’en annexe de ce qu’il contient que je signale la parution de mes livres – le médium le permettant aisément.
J’ai, à ce propos, un peu hésité à faire de "l’auto-promotion" sur mon blogue, ici-même. Mais il fallait aller jusqu’au bout. Ne pas signaler mon livre à tout voyageur de passage eût été cette vanité invisible qu’on affuble souvent du beau nom, ici usurpé, de retenue – et qui ne sied qu’aux princes protégés. Il est trop facile de répéter la parole de Baudelaire selon laquelle l’art serait Prostitution, et s’en aller avec l’air las, et entendu, de celui qui prétend avoir tout éprouvé…
Je sais bien que l’indifférence est maîtresse aujourd’hui comme toujours, ou plutôt je sais bien que l’intérêt s’émousse désormais en trois jours et se disperse avec le vent du temps – et qu’il n’est partout qu’inconstance. Dès lors celui qui s’arrêtera devant mon livre n’aura fait que répondre à une invitation.
J. de R. -. Que pensez-vous, à ce propos, des réseaux dits "sociaux" pour diffuser votre œuvre ?
F. T. -. Il suffit d’avoir un peu pratiqué Facebook pour se rendre compte que tout cela est une vaste plaisanterie : les échanges n’y sont jamais que brefs, inconsistants, volatils, et la plupart des personnes qui vous demandent en "ami", comme on dit, ne commentent jamais vos publications, mais au contraire vous abreuvent de liens hypertextes dérisoires ou de leurs commentaires grossièrement intimes sur des pages de personnes qui vous sont parfaitement inconnues. Les seuls échanges dignes de ce nom ont lieu avec des personnes que vous connaissez déjà, dans "la vie réelle" ; et je ne vois guère l’intérêt à ce qu’ils s’étalent ainsi aux yeux de tous. Pour élargir la problématique à l’Internet tout entier, je dirais que le leurre de la "Communication" ne peut pas ne pas trouver là sa meilleure preuve : chacun n’écoute au fond que soi, et ne parle que de soi, en espérant capter une attention fragile, vagabonde, instable, complètement soumise aux aléas du monde moderne, lesquels se nomment vitesse, indifférence et "zapping". Quand j’ai créé mon premier blogue, en mai 2008, je ne l’ai pas envisagé comme un lieu de rencontres possibles, mais comme un livre virtuel, comme une "œuvre" ; les commentaires "postés" ici et là me faisaient plaisir comme font plaisir à un auteur les lettres de ses lecteurs (… ou devraient le faire, car je connais, ou j’en ai entendu parler, des auteurs qui ne répondent pas à leurs lecteurs, ce qui me semble le comble de la grossièreté). Mais il ne me semblait pas que mon blogue fût un lieu d’échange, ou bien cet échange supposait au préalable que je connusse l’auteur du commentaire : à quoi bon dialoguer avec un être au pseudonyme souvent ridicule, ou que je ne connais ni d’Ève ni d’Adam ? J’ai cependant connu deux personnes grâce à cet outil, avec lesquelles j’ai plaisir à m’entretenir virtuellement. Vous me direz peut-être que c’est peu, mais selon moi c’est immense, car il s’agit là de personnes tout à fait admirables. Je les salue ici au passage. C’est moi qui ai contacté la première, et même si nous n’avons encore jamais eu l’occasion de nous rencontrer, nos échanges épistolaires sont désormais riches de plusieurs années, et suffisamment féconds pour que je puisse parler d’estime et d’intérêt réciproques. L’autre personne (c’est à dessein que je reste vague, bien entendu) s’est manifestée à moi à la suite d’un article mien qui lui avait plu, et nous nous sommes vite aperçus que nous avions des goûts et des intérêts communs ; nous nous sommes rencontrés physiquement, et je dois dire que je suis reconnaissant à l’Internet d’avoir permis, dans ce cas, cette rencontre qui sans cet outil n’aurait sans doute jamais eu lieu. Quant au reste… Je préfère des lecteurs silencieux (ou qui m’écrivent en privé) et des commentateurs amicaux, sur mon blogue, à des personnes qui, ayant entendu parler de moi, ne prennent contact avec moi que dans le but d’étoffer leur nombre de connaissances virtuelles. Et par-dessus tout, je préfère parler avec quelqu’un autour d’une tasse de café que devant mon ordinateur, que devant l’eau froide par l’ennui dans son écran gelée... (Ô Hérodiade !)
J. de R. -. Revenons, si vous le voulez bien, à la poésie. Nous avons évoqué "la poésie" d’une manière, me semble-t-il, assez vague, de nature tout du moins à entretenir la confusion qui règne souvent à son propos. J’aimerais revenir sur ce point que vous avez esquissé, dans la mesure où votre position peut sembler ambiguë : vous placez très haut la poésie, mais parfois vous ne semblez pas parler tout à fait d’elle, je veux dire dans son acception purement littéraire. La poésie dont vous parlez ne pourrait désigner que l’acception très large, et certes honorable, du mot : vous évoquiez vous-même la poésie d’un paysage : votre coquelicot, que vous donnez comme définition de la poésie, et dont vous disiez qu’il était « au bord des chemins, en leurs marges, sauvage… », ne demandant que « l’œil amoureux…, dans l’ornière », pourrait sembler en faire partie, et s’y réduire. Or, si beaucoup de monde en effet peut être sensible à cette poésie-là, c’est parce qu’elle reste vague et n’engage à rien. Elle n’est pas non plus suffisante pour créer un texte littéraire, ni n’est en mesure de le faire apprécier… La poésie, elle, n’est pas aimée de tous, ou plutôt n’est pas fréquentée par tous dans son acception exigeante. Comment dès lors dégager la poésie des considérations vagues qui la noient ?
F. T. -. Mon pauvre coquelicot en prend pour son grade : mais je n’ai pas dit qu’il était la définition de la poésie, j’ai dit qu’il en était l’image, c’est-à-dire le pressentiment, le contour, ou même, en quelque sorte, l’avenir...
Ce que vous me dites me fait songer à la phrase de Paul Valéry selon laquelle – je cite de mémoire, mais je crois justement – « la plupart des gens se font de la poésie une idée si vague qu’ils prennent ce vague pour l’idée même de la poésie »… C’est évidemment ce que l’on observe souvent ; je remarquerai cependant que cette idée vague peut permettre, malgré sa naïveté, une introduction à la poésie elle-même – qu’elle lui est a priori favorable. C’est quand elle se substitue à la poésie qu’elle est néfaste. Sinon, ce sens vague de "poésie d’un paysage" ne me gêne pas ; il rejoint l’idée de la beauté, qui est indéfinissable et pourtant tangible, lorsque, luttant contre les champions relativistes pour lesquels il n’y a pas de Beau "en soi", nous savons – "je" sais – très bien que ce n’est pas vrai, qu’il y a de la beauté dans ce jardin, et qu’il n’y en a pas dans ce square de béton au milieu des tristes barres de banlieues – qu’il y en a davantage dans un tableau de Hans Memling ou Eugène Delacroix que dans les "tags" immondes et dégoulinants de laideur qui fleurissent désormais même dans Paris et que pourtant nos ministres de la Culture érigent sottement en œuvres d’art. Je n’ignore pas du tout ce que cette proposition a de contestable "philosophiquement", et qu’elle s’oppose à l’adage qui m’horripile sur "les goûts et les couleurs", mais mon œil et mon cœur s’en moquent éperdument. Aimer, en ce sens, c’est choisir, c’est élire, c’est être injuste et partial consciemment…
J’effectue cette distinction au sein même de l’art digne de ce nom : par exemple, les toiles pleines d’angles sales et pointus de Bernard Buffet représentent le paradigme de mes détestations en matière d’art : je n’ai que rarement vu quelque chose d’aussi laid, d’aussi inutilement laid, plus laid même que certaines choses laides du monde, ce qui est peu dire ; la peinture de Bernard Buffet est une véritable horreur pour moi ; et c’est tant mieux. Je goûte également très peu l’œuvre de Picasso, pour d’autres raisons. Cela ne veut pas dire que je leur refuse sottement le statut d’œuvres d’art…
Aussi bien je suis très attaché à la hiérarchie des choses. Aimer, c’est élire, c’est distinguer, c’est séparer, ce n’est jamais égaliser, aplatir, c’est mettre en haut et en bas, et au milieu. Dire de quelque chose que cela est supérieur ne signifie pas un mépris pour ce qui lui est inférieur, mais une simple reconnaissance. J’aime passionnément le groupe musical anglais And Also The Trees, mais il ne me viendrait jamais à l’idée de dire que ses belles chansons sont égales à la musique, celle qui va de Guillaume de Machaut, mettons, à Sibelius, Ravel ou Dutilleux. Il y a certes toujours des passerelles, les degrés de l’échelle sont parfois mouvants, et par exemple les textes des chansons écrits par Simon Huw Jones, le chanteur d’And Also The Trees, sont souvent de véritables poèmes de langue anglaise, mais il n’y a rien de plus néfaste à l’art et à la "culture" que de tout aplatir au nom d’une prétendue tolérance. À ce titre, même si l’exemple me sera reproché comme caricatural, si nous refusons la hiérarchie, la chanson la plus inepte du monde, par exemple La Danse des canards, sera l’égale de l’aria What Power Art Thou (la fameuse Cold Song) de Purcell ou de La Mort d’Isolde de Wagner. Mais cet exemple est-il si ridicule, quand nous ouvrons la radio et que nous entendons parler de tel chanteur de variétés comme d’un compositeur ?
Mais revenons à "la poésie". Qu’est-ce donc que la poésie ?... Aussi bien je n’en ai qu’une idée personnelle, selon mes propres essais bien sûr, mais selon, surtout, et d’abord, ce que j’en ai lu. La définir me semble surhumain. La Poésie me semble une très longue trame à travers le langage, une lame de fond pourrais-je dire, dont les poètes, à travers le temps, ont tenté de dénouer le fil, de transcrire le flux, à travers les outils dont leurs époques leur ont fourni l’usage. C’est une sorte de flambeau, celui que se passent les athlètes d’une épreuve de course. Il faut nécessairement distinguer le langage, l’assemblage de mots sur une page – mais ce n’est pas suffisant. Et cette insuffisance n’adoube pas, bien entendu, l’acception vague de "poésie d’un paysage". Mais s’il est question de langage, c’est que le "drame", au sens d’action, de la poésie, s’y joue.
On a pu dire que le Poète avait pris conscience, dans les temps modernes, que la Muse était le Langage lui-même, et non plus quelque Déité. Mais c’est faire trop de cas de la conscience moderne, comme si elle était supérieure à l’antique ou plus lucide que celle de l’âge classique, comme si le premier poète n’avait pas également réfléchi, et intensément, au langage dont il disposait !
À toutes les "définitions" de la poésie, je préfère la réponse de Mallarmé au critique littéraire Léo d’Orfer qui lui posait presque la même question, réponse que, pour nos Lecteurs, vous me permettrez de citer in extenso, tant la brève lettre, datée du 27 juin 1884, est belle :
Mon cher Monsieur d’Orfer,
C’est un coup de poing, dont on a la vue, un instant, éblouie ! que votre injonction brusque –
« Définissez la Poésie »
Je balbutie, meurtri :
« La Poésie est l’expression, par le langage humain ramené à son rythme essentiel, du sens mystérieux des aspects de l’existence : elle doue ainsi d’authenticité notre séjour et constitue la seule tâche spirituelle ».
Au revoir ; mais faites-moi des excuses.
Stéphane Mallarmé.
La "définition" proposée par Mallarmé supporterait des développements infinis, mais j’en retiendrai, pour le moment, ce qui l’encadre : « Je balbutie, meurtri » et « mais faites-moi des excuses » ; au-delà de l’afféterie apparente, et de cette délicieuse et unique préciosité mallarméenne, une parole essentielle est prononcée. À l’instar – profane ! – du tétragramme hébraïque YHWH, qui permet de désigner Dieu sans le nommer à la fin, Mallarmé met à distance la définition possible de la poésie en l’articulant avec précaution, en la balbutiant, en ouvrant de délicats guillemets ; la phrase qu’il propose a beau être étincelante, et infinie dans ses suggestions, elle n’en est pas moins, malgré son autorité, une indication, un avenir – cette fameuse « tâche spirituelle » (et qu’est-ce, d’ailleurs, qu’une « tâche spirituelle » selon Mallarmé ? Nous y reviendrons peut-être…).
Cela dit, je ne me déroberai pas à votre question en me parant des mots d’autrui : pour moi, la poésie serait le visage conféré aux mots, au langage – créer un visage aux mots, au langage tout entier serait ce qui lui incombe, en quelque sorte. En ce sens, la poésie serait le visage du langage, son plus beau, son plus juste visage, les traits de ce visage aussi bien, dont le Talmud dit qu’avec l’âme, c’est ce que Dieu, à la mort d’un homme, reprend de sa créature… Et ce langage, le langage humain, a-t-il sans doute contribué à façonner le visage humain ; aussi bien c’est une quête à travers les images du monde.
J. de R. -. N’est-ce pas là une définition de la poésie ?
F. T. -. Oh non… Tout ce qui parle de la poésie est en dessous d’elle, le pire étant, avec le jargon universitaire qui la noie sous des considérations formalistes, la "prose (faussement) poétique" critique qui s’efforce de la cerner en l’analysant. On ne peut que tâtonner autour de la poésie, indiquer des pistes, frayer quelques ronces. Peut-être ne pouvons-nous pas parler de la poésie – mais nous pouvons parler tout près d’elle, auprès d’elle. On parle souvent d’un tableau qui, à force de regards, et comme en récompense, en don de soi, « se lève », selon l’expression des frères Goncourt. Un poème, un beau poème aussi se lève. Celui qui parle de poésie ne peut que l’évoquer – et la traquer…
(à suivre.)
14:26 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens | Tags : frédéric tison, jean de rancé, entretiens, poésie | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
lundi, 16 septembre 2013
Interview with Jean de Rancé : "Une autre ville" at the Orléans Museum of Fine Arts
Ceci est la traduction en anglais, par Danny Rukavina, d'un entretien paru récemment ici-même.
*
Jean de Rancé. -. Soon at the Orléans Museum of Fine Arts, an exhibition devoted to Renaud Allirand. Among the works by this artist includes a book, Une autre ville, for which you wrote the text. Frédéric Tison could you tell us about how this book came about ?
Frédéric Tison. -. Actually, Jean de Rancé, it’s not so much a book as a journal. In fact, it’s a collection of poems, 24 pages in large format, illustrated by Renaud Allirand, as a result of a marvellous meeting. The story behind this collaboration originates in a walk that dates to the winter of 2011. I sometimes go with a dear friend to visit contemporary art galleries in the different streets of the Marais in Paris. One day we entered Renaud Allirand’s workshop in rue Debelleyme and I was stunned by the beauty of some gouaches that were displayed in the window. I bought some postcard copies from a discreet young man who was there and whom I didn’t notice immediately. Later, in doing some research on the Internet, I realised that the young man I saw was in fact the artist. A little bit later, I went back and asked Renaud Allirand if I could take some photos of his gallery to post on my blog. He gave me his permission willingly and was very nice about it. I decided to put into writing my impressions about the artist & engraver to go with the photos, which I sent him. He invited me to come and see him again. This time, to expand on what I wrote with the goal of presenting his work in future exhibitions, which I did. And that’s how our friendship began. On his own initiative, he took an interest in my work and a few months later in the autumn of 2012 he asked me about a possible joint venture. I suggested using five unpublished poems I wrote entitled Une autre ville which were to his liking. He gave me a series of drawings in Indian ink and engravings to illustrate the poems. We then put together a mock-up of the work and looked for a publisher. In February 2013 the journal Une autre ville came out. The first thirty copies included an original drawing in Indian ink.
J. de R. -. In a few words, what attracted you in Renaud Allirand’s work ?
F. T. -. I particularly like in Renaud Allirand’s work that indeterminateness found in dreams, a mixture of abstraction and reality. Even if the material of a work is a very important element, one never ‘trips’ on it ; you can look at it and ask yourself : is it a window, a tree, a landscape seen or something imagined from afar, a city in the night, a shadow of a palace, an abandoned port, a shipwreck, a starry sky, or an open book ? Hardly has one decided on a possible interpretation when the image disappears or vanishes in the ‘traces’ of ink in the gouache or the contours of the lines. And then one sees the stain, the stroke, the colour of the tree or window that reveal themselves again. The sheer beauty of the works also resides there in their hard to pin down nature. In terms of the poems of Une autre ville which evoke fallen figures and hover around absence and loss, Renaud Allirand and I felt a harmony to exist between the images and the text.
J. de R. -. Do you have any joint projects in the future ?
F. T. -. Seeing that this first project was well received, I don’t see any reason why it should be the last.
*
Une autre ville will be available at the Orléans Museum of Fine Arts bookshop to coincide with Renaud Allirand’s exhibition in the graphic arts department from September 5th to December 8th 2013.
Translation by Danny Rukavina.
11:21 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens | Tags : frédéric tison, jean de rancé, entretien, une autre ville, traduction, renaud allirand | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook |
Facebook |
dimanche, 01 septembre 2013
Entretien avec Jean de Rancé : sur "Une autre ville", au musée des beaux-arts d'Orléans
Jean de Rancé. -. Aura lieu bientôt, au musée des beaux-arts d’Orléans, une exposition consacrée à Renaud Allirand. Parmi les œuvres de cet artiste figure un livre, dont vous avez écrit les textes, Une autre ville. Pourriez-vous, cher Frédéric Tison, nous raconter la genèse de ce livre ?
Frédéric Tison. -. Il s’agit, cher Jean de Rancé, moins d’un livre que d’un cahier, puisque le volume, de grand format, comporte 24 pages, un cahier de poèmes qu’illustra Renaud Allirand, à l’occasion d’une rencontre magnifique. L’histoire de cette collaboration, en effet, prend sa source dans une promenade, qui remonte à l’hiver 2011. Je me rends quelquefois, en compagnie d’une amie chère, dans les rues du Marais, à Paris, afin de visiter les galeries d’art contemporain. Nous entrâmes un jour dans l’atelier de Renaud Allirand, rue Debelleyme ; j’avais été frappé par la beauté de certaines gouaches exposées dans la vitrine. J’achetai quelques reproductions en carte postale à un jeune homme discret qui était là et dont je m’aperçus ensuite, en faisant une recherche sur l’Internet, qu’il s’agissait de l’artiste lui-même ! Un peu plus tard, je retournai sur les lieux, et demandai à Renaud Allirand s’il m’autorisait à prendre quelques photographies de sa galerie afin d’en publier une sur mon blogue, ce à quoi l’artiste consentit très volontiers, avec beaucoup de gentillesse. Je décidai d’accompagner ma photographie d’un petit texte de présentation, impressions sur les œuvres du peintre et graveur que j’envoyai à l’artiste. Celui-ci m’invita à le visiter de nouveau, pour cette fois me demander d’étoffer mon petit texte, ce dernier étant destiné à présenter ses œuvres, lors de ses expositions à venir – ce que je fis. Notre amitié est née ainsi. Renaud Allirand s’était de son côté enquis de mes propres écrits, et quelques mois plus tard, à l’automne 2012, il me sollicita pour un éventuel livre à quatre mains. Je lui proposai les cinq poèmes inédits intitulés Une autre ville, qui surent lui plaire, et l’artiste me proposa une suite d’encres de Chine et de gravures destinée à illustrer les poèmes en regard. Nous avons ensuite élaboré la maquette de l’ouvrage, avons cherché un imprimeur et, en février 2013, paraissait le cahier Une autre ville, dont trente exemplaires de tête étaient enrichis d’une encre de Chine originale.
J. de R. -. Ce cahier est donc l’aboutissement d’un très heureux hasard !
F. T. -. Sans appartenir à l’Institut Métapsychique International, j’aime volontiers croire au hasard objectif…
J. de R. -. En quelques mots, qu’est-ce qui vous a séduit dans l’œuvre de Renaud Allirand ?
F. T. -. J’aime, particulièrement, chez Renaud Allirand, cette indécision, propice au rêve, entre l’abstraction et la figuration. Si, en effet, la matière de l’œuvre est une donnée très importante, on ne "bute" jamais sur elle, et le regard peut s’interroger : s’agit-il, selon, d’une fenêtre, d’un arbre, d’un paysage vu, ou d’un lointain imaginaire, d’une ville dans la nuit, de l’ombre d’un palais, d’un port abandonné, d’un navire brisé, d’un ciel d’étoiles ou d’un livre entrebâillé ? À peine a-t-on décidé d’une interprétation, à peine a-t-on élu telle représentation que l’image se dérobe ou s’efface dans le "grain" de l’encre, de la gouache ou du sillon de la ligne. Et voit-on, alors, la tache, le trait, la couleur, que l’arbre ou la fenêtre de nouveau s’entr’ouvrent. L’évidente beauté de ces œuvres est aussi là, dans ce caractère insaisissable. Et, en ce qui concerne les poèmes d’Une autre ville, qui évoquent des figures effondrées, et rôdent autour de l’absence et de la perte, l’harmonie entre l’image et le texte nous est apparue, à Renaud Allirand et moi, manifeste.
J. de R. -. Avez-vous des projets en commun pour l’avenir ?
F. T. -. Puisque ce premier projet a su plaire, je ne vois pas pourquoi il demeurerait le dernier.
*
L'ouvrage Une autre ville sera présenté à la librairie du musée des beaux-arts d’Orléans, à l’occasion de l’exposition de Renaud Allirand au Cabinet des Arts graphiques, du 5 septembre au 8 décembre 2013.
18:24 Écrit par Frédéric Tison dans Entretiens | Tags : frédéric tison, entretien, jean de rancé, renaud allirand, une autre ville, musée des beaux-arts d'orléans | Lien permanent | Commentaires (3) | ![]() Facebook |
Facebook |